Le projet d'innovation pour faire de votre idée un succès commercial
 Que vous soyez salarié en charge de l'innovation, chef d'entreprise en recherche de diversification, sous-traitant à la recherche du mythique "produit propre" ou encore candidat à la création d'entreprise, ce chapitre vous concerne. Il passe en revue tous les aspects du projet d'innovation. De l'approche marketing à la mise en marché, en passant par la conception et la réalisation du produit,.
Que vous soyez salarié en charge de l'innovation, chef d'entreprise en recherche de diversification, sous-traitant à la recherche du mythique "produit propre" ou encore candidat à la création d'entreprise, ce chapitre vous concerne. Il passe en revue tous les aspects du projet d'innovation. De l'approche marketing à la mise en marché, en passant par la conception et la réalisation du produit,.Ce serait une profonde erreur de piloter un projet d'innovation comme un projet classique. Ici on est dans l'incertain, dans les "sciences molles". Plus encore que dans tout autre type de projet, l'humain est la clé du succès. Jusqu'aux outils méthodologiques qui sont propres à la démarche d'innovation : Vous ne connaissez pas Océan bleu et son canevas stratégique ? Le Business model canvas vous est inconnu ? Vous pensez comme beaucoup que l'on peut breveter une bonne idée ? Alors, bienvenue dans ce chapitre et bon apprentissage.
Cliquez sur la barre de titre pour voir le contenu de la leçon
- Deux projets d’innovation sur trois échouent… et votre prochain ?
- Une définition de l’innovation
- Entre découverte et évidence, le domaine de l’innovation
- L’innovation incrémentale
- Innovation de rupture et mur technologique
- Les champs d’innovation
- La sérendipité, kézaco ?
- De la sérendipité à la bissociation
- Le biomimétisme
- Quelques démarches type d’innovation
- Un exemple d’innovation réussie
- Innover n’a jamais été aussi facile
Deux projets d’innovation sur trois échouent… et votre prochain ?
 Voici une statistique qui surprend, bien qu’elle soit confirmée par les sources les plus sérieuses : deux projets d’innovation sur trois échouent. C’est une moyenne. Parmi les secteurs les plus sinistrés figurent en bonne place les projets informatiques. Pour les projets informatiques justement, le diagnostic a été fait maintes fois et des solutions se mettent en place progressivement. Comme par exemple les méthodes agiles (qui sont traitées sur ce site dans un autre chapitre). Pour ce qui est du projet d’innovation on pourrait penser que l’échec est lié à l’incertitude inhérente au domaine. Il n’en est rien. Le manque d’organisation et l’ignorance des méthodes et des outils de la démarche d’innovation suffisent à expliquer bien des échecs. Ajoutons à cela l’individualisme et le fonctionnement « en silo » des entreprises et le tableau sera complet. Ceci posé, assez parlé des échecs et voyons comment on doit s’y prendre pour réussir !
Voici une statistique qui surprend, bien qu’elle soit confirmée par les sources les plus sérieuses : deux projets d’innovation sur trois échouent. C’est une moyenne. Parmi les secteurs les plus sinistrés figurent en bonne place les projets informatiques. Pour les projets informatiques justement, le diagnostic a été fait maintes fois et des solutions se mettent en place progressivement. Comme par exemple les méthodes agiles (qui sont traitées sur ce site dans un autre chapitre). Pour ce qui est du projet d’innovation on pourrait penser que l’échec est lié à l’incertitude inhérente au domaine. Il n’en est rien. Le manque d’organisation et l’ignorance des méthodes et des outils de la démarche d’innovation suffisent à expliquer bien des échecs. Ajoutons à cela l’individualisme et le fonctionnement « en silo » des entreprises et le tableau sera complet. Ceci posé, assez parlé des échecs et voyons comment on doit s’y prendre pour réussir !Une définition de l’innovation
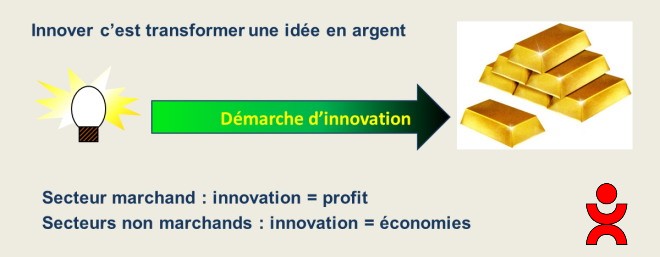 Il existe différentes définitions de l’innovation. Tant qu’à en choisir une et au risque de choquer, voici ma préférée : « Innover c’est transformer une idée en argent ». Voici d’autres définitions et points de vue sur l’innovation. Pour André-Yves Portnoff, l’innovation correspond à la mise en pratique dans la sphère marchande d’une idée plus ou moins nouvelle. Selon Théodore Levitt, la créativité c’est penser des nouvelles choses, l’innovation c’est faire de nouvelles choses. Finissons par cet intéressant point de vue : la recherche transforme de l’argent en savoir, l’innovation transforme du savoir en argent.
Il existe différentes définitions de l’innovation. Tant qu’à en choisir une et au risque de choquer, voici ma préférée : « Innover c’est transformer une idée en argent ». Voici d’autres définitions et points de vue sur l’innovation. Pour André-Yves Portnoff, l’innovation correspond à la mise en pratique dans la sphère marchande d’une idée plus ou moins nouvelle. Selon Théodore Levitt, la créativité c’est penser des nouvelles choses, l’innovation c’est faire de nouvelles choses. Finissons par cet intéressant point de vue : la recherche transforme de l’argent en savoir, l’innovation transforme du savoir en argent.Entre découverte et évidence, le domaine du projet d’innovation
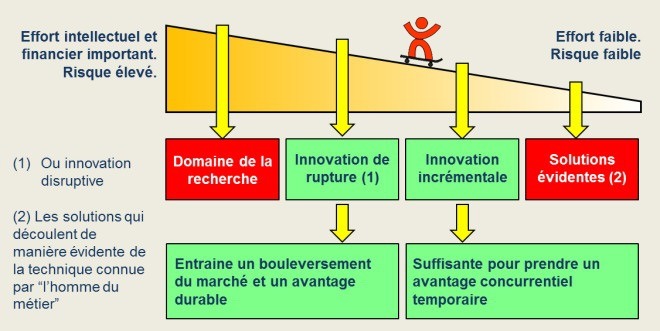 S’agissant de créer du nouveau, il n’y a pas de discontinuité entre les grandes découvertes (à gauche sur le schéma) et les solutions que chacun d’entre nous imagine pour résoudre les problèmes du quotidien (à droite). Tout est affaire de degré. Le domaine de l’innovation est clairement positionné entre les deux extrêmes. Et à l’intérieur même de ce domaine il existe une infinité de degrés. Schématiquement on distingue deux types d’innovation. L’innovation incrémentale est peu risquée et demande un effort relativement faible. Et l’innovation de rupture (dite également innovation disruptive ou même disruption), est bien plus rare et très risquée. Voici ci-dessous un exemple de chacun de ces types d’innovation :
S’agissant de créer du nouveau, il n’y a pas de discontinuité entre les grandes découvertes (à gauche sur le schéma) et les solutions que chacun d’entre nous imagine pour résoudre les problèmes du quotidien (à droite). Tout est affaire de degré. Le domaine de l’innovation est clairement positionné entre les deux extrêmes. Et à l’intérieur même de ce domaine il existe une infinité de degrés. Schématiquement on distingue deux types d’innovation. L’innovation incrémentale est peu risquée et demande un effort relativement faible. Et l’innovation de rupture (dite également innovation disruptive ou même disruption), est bien plus rare et très risquée. Voici ci-dessous un exemple de chacun de ces types d’innovation :L’innovation incrémentale
 Le monde de l’automobile est un excellent exemple d’innovation incrémentale. Il y a presque un siècle entre la Ford T et des véhicules récents comme ici la Seat Ibiza. Que de progrès, direz-vous. Oui, bien entendu, pas de climatisation sur la Ford T, ni d’ABS, ni d’airbag. Mais reconnaissez que la structure du produit est globalement la même. Quatre roues dont deux directrices à l’avant, une carrosserie, des portières pivotantes, un moteur thermique à 4 temps. On n’en finirait pas d’énumérer les points communs.
Le monde de l’automobile est un excellent exemple d’innovation incrémentale. Il y a presque un siècle entre la Ford T et des véhicules récents comme ici la Seat Ibiza. Que de progrès, direz-vous. Oui, bien entendu, pas de climatisation sur la Ford T, ni d’ABS, ni d’airbag. Mais reconnaissez que la structure du produit est globalement la même. Quatre roues dont deux directrices à l’avant, une carrosserie, des portières pivotantes, un moteur thermique à 4 temps. On n’en finirait pas d’énumérer les points communs.L’innovation incrémentale ne bouleverse pas le domaine. Elle consiste en une amélioration du produit existant qui a généralement pour but de créer un avantage concurrentiel. Lequel avantage sera momentané car les concurrents ne manqueront pas d’adopter le nouveau dispositif, qui deviendra vite un équipement standard.
Innovation de rupture et mur technologique
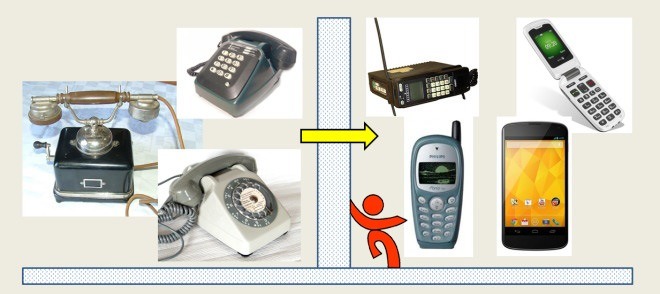 Autre exemple, typique celui-ci de l’innovation de rupture (ou disruptive pour les snobs) : la téléphonie. La plupart d’entre nous ont connu le téléphone filaire et les cabines de téléphone publiques. L’idée du téléphone mobile était pourtant dans toutes les têtes : Les enfants des années 1960 jouaient avec des talkies-walkies. Dix ans plus tard, devenus automobilistes ils se passionnaient pour la « CB » (Citizen Band). C’est dire que la transmission audio sans fil était connue de tous et économiquement accessible. Les premiers prototypes de téléphone « cellulaire » sont apparus en 1973 aux États-Unis. Et pourtant il a fallu attendre le tout début des années 2000 pour que …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
Autre exemple, typique celui-ci de l’innovation de rupture (ou disruptive pour les snobs) : la téléphonie. La plupart d’entre nous ont connu le téléphone filaire et les cabines de téléphone publiques. L’idée du téléphone mobile était pourtant dans toutes les têtes : Les enfants des années 1960 jouaient avec des talkies-walkies. Dix ans plus tard, devenus automobilistes ils se passionnaient pour la « CB » (Citizen Band). C’est dire que la transmission audio sans fil était connue de tous et économiquement accessible. Les premiers prototypes de téléphone « cellulaire » sont apparus en 1973 aux États-Unis. Et pourtant il a fallu attendre le tout début des années 2000 pour que …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
Les champs d’innovation
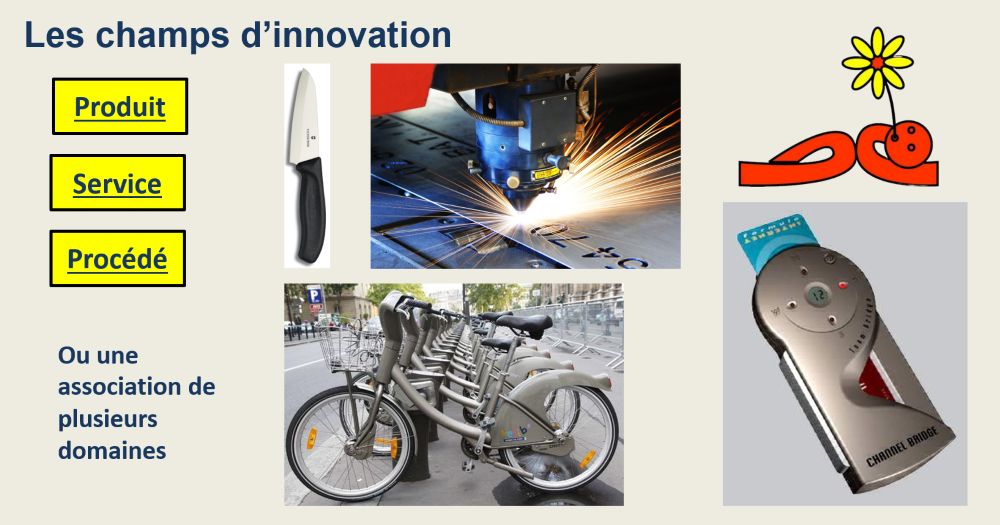 On associe souvent l’innovation au produit industriel. C’est d’ailleurs ce que j’ai fait dans les exemples précédents (automobile et téléphone). On peut fort heureusement innover dans d’autres domaines que celui-ci.
On associe souvent l’innovation au produit industriel. C’est d’ailleurs ce que j’ai fait dans les exemples précédents (automobile et téléphone). On peut fort heureusement innover dans d’autres domaines que celui-ci.Par exemple dans l’innovation de service. Celle-ci consiste soit à associer un service à un produit existant, soit à créer une nouvelle activité de service. Les nouvelles technologies permettent l’émergence et le succès rapide de nouveaux services. Citons en vrac le covoiturage, le e-learning, la vente de particulier à particulier, les circuits courts de distribution…
L’innovation de procédé porte sur la façon de …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
La sérendipité, kézaco ?
 Le mot « sérendipité » est revenu récemment à la mode. La sérendipité c’est le constat que l’on trouve le plus souvent ce que l’on ne cherchait pas ! Les quatre exemples ci-contre sont connus. Le très célèbre et très lucratif post-it, c’est l’histoire d’une colle qui ne collait pas. Le Roquefort c’est la contamination accidentelle du fromage par une moisissure. La tarte tatin est issue de la maladresse d’une restauratrice de Lamothe-Beuvron, en Sologne. Alexander Flemming quant à lui constate à son retour de vacances que ses cultures de bactéries ont été détruites. Le coupable ? un champignon microscopique, le pénicillium. C’est le début de la grande aventure des antibiotiques. On ne saura jamais combien d’innovations n’ont pas vu le jour parce que les équipes de projet d’innovation étaient tendues vers l’objectif qui leur était assigné. Et ont laissé de coté des idées peut-être plus prometteuses que l’objet de leur recherche. En pratique, soyez curieux, soyez observateur, et faites confiance au hasard.
Le mot « sérendipité » est revenu récemment à la mode. La sérendipité c’est le constat que l’on trouve le plus souvent ce que l’on ne cherchait pas ! Les quatre exemples ci-contre sont connus. Le très célèbre et très lucratif post-it, c’est l’histoire d’une colle qui ne collait pas. Le Roquefort c’est la contamination accidentelle du fromage par une moisissure. La tarte tatin est issue de la maladresse d’une restauratrice de Lamothe-Beuvron, en Sologne. Alexander Flemming quant à lui constate à son retour de vacances que ses cultures de bactéries ont été détruites. Le coupable ? un champignon microscopique, le pénicillium. C’est le début de la grande aventure des antibiotiques. On ne saura jamais combien d’innovations n’ont pas vu le jour parce que les équipes de projet d’innovation étaient tendues vers l’objectif qui leur était assigné. Et ont laissé de coté des idées peut-être plus prometteuses que l’objet de leur recherche. En pratique, soyez curieux, soyez observateur, et faites confiance au hasard.De la sérendipité à la bissociation
 La sérendipité ne demande aucun effort puisque c’est le hasard qui crée la nouveauté. Les seule qualité requises pour que le produit du hasard devienne innovation sont le sens de l’observation et l’opportunisme. Il n’en est pas de même pour la bissociation qui demande un réel effort d’imagination. Le concept de bissociation a été créé par l’écrivain Arthur Koestler. Il l’a décrit dans son livre « Le cri d’Archimède ». La bissociation consiste à combiner dans le nouveau produit deux concepts qui appartenaient jusque là à des univers différents. Les exemples ci-contre en sont l’illustration. Le kitesurf est l’association d’une planche de surf et d’un cerf volant. La motoneige réunit en un seul objet une moto, des skis et une chenille. Le roller est l’union d’une chaussure de ski et d’un patin à roulette modifié. Le code-barre serait inspiré de l’écriture Braille et du système de lecture des bandes-son au cinéma. Pour finir, Gutemberg se serait inspiré du pressoir à raisin et du sceau pour inventer sa presse à imprimer
La sérendipité ne demande aucun effort puisque c’est le hasard qui crée la nouveauté. Les seule qualité requises pour que le produit du hasard devienne innovation sont le sens de l’observation et l’opportunisme. Il n’en est pas de même pour la bissociation qui demande un réel effort d’imagination. Le concept de bissociation a été créé par l’écrivain Arthur Koestler. Il l’a décrit dans son livre « Le cri d’Archimède ». La bissociation consiste à combiner dans le nouveau produit deux concepts qui appartenaient jusque là à des univers différents. Les exemples ci-contre en sont l’illustration. Le kitesurf est l’association d’une planche de surf et d’un cerf volant. La motoneige réunit en un seul objet une moto, des skis et une chenille. Le roller est l’union d’une chaussure de ski et d’un patin à roulette modifié. Le code-barre serait inspiré de l’écriture Braille et du système de lecture des bandes-son au cinéma. Pour finir, Gutemberg se serait inspiré du pressoir à raisin et du sceau pour inventer sa presse à imprimerLe biomimétisme dans le projet d’innovation
 Le biomimétisme est un processus volontaire et organisé. L’idée de départ est de transférer dans le domaine technologique des solutions existante dans le domaine du vivant. Voici cinq exemples correspondant aux cinq illustrations ci-contre.
Le biomimétisme est un processus volontaire et organisé. L’idée de départ est de transférer dans le domaine technologique des solutions existante dans le domaine du vivant. Voici cinq exemples correspondant aux cinq illustrations ci-contre.– Le gecko est un sympathique reptile. Sa particularité est de se déplacer au plafond d’une cage en verre. Et même d’y rester suspendu par un seul doigt. De nombreuses équipes de chercheurs ont travaillé et travaillent sur ce seul sujet. Le secret du gecko résiderait dans nano-structure de sa peau, qui met en jeu les forces de Van der Vaals. Les applications pratiques sont à venir.
– Le martin pécheur est un plongeur étonnant. Il pénètre dans l’eau bec en avant en produisant un minimum de remous et surtout sans aucun bruit. Eiji Nakatsu, l’ingénieur qui dirigeait les essais du train à grande vitesse japonais se heurtait à un gros problème …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
Quelques démarches de projet d’innovation
 On distingue au moins cinq démarches d’innovation spécifiques :
On distingue au moins cinq démarches d’innovation spécifiques :– Le concept d’innovation ouverte recouvre des réalités très différences. Dans une vision étroite l’innovation ouverte est basée sur la coopération entre entreprises. Et plus précisément entre grands comptes et petites entreprises. Dans une vision plus large c’est la mise dans le domaine public des créations de l’entreprise. C’est le cas désormais habituel des logiciels open source. Plus étonnant le cas des constructeurs automobiles TESLA et TOYOTA, qui libèrent tout ou partie de leurs brevets.
– Celui d’innovation tirée par les usages consiste à observer des clients en situation d’utiliser des produits et services. Puis à transformer leurs pratiques ou leurs insatisfaction en voies d’innovation.
– L’innovation est dite tirée par une communauté lorsque l’entreprise encourage une communauté à contribuer activement au processus d’innovation. Notamment en testant ses nouveaux produits.
– Consistant à repenser une offre initialement destinées à une cible favorisée pour l’adapter aux populations à faible pouvoir d’achat l’innovation est dite bottom of the pyramid
– Inspirée par les chercheurs indiens capables de créations ingénieuses avec des moyens rudimentaires, l’innovation frugale (ou Jugaad) consiste précisément à proposer des solutions simples et économiques. Le livre « L’innovation Jugaad » a popularisé le concep. Et les dirigeants de grandes entreprises ont très vite traduit « jugaad » par « innovation low-cost »
Un exemple d’innovation réussie
 Voici deux objets qui ont le même usage : maintenir verticale une feuille de papier. Le support de gauche est de toute évidence issu d’un bureau d’études classique. En voyant l’objet on lit dans les pensées du concepteur. « J’appuie la feuille sur une surface plane, elle repose en partie basse sur un talon. Je la maintiens en partie haute par une pince. Je stabilise le tout par une jambe de force articulée située à l’arrière. Et j’ajoute pour finir une règle transparente réglable en hauteur pour permettre une lecture ligne par ligne ». De la conception réglée, avec au final un produit cher, inutilement complexe (vous vous voyez déplacer la règle à chaque ligne ?) et fragile. L’objet de droite est d’une surprenante simplicité. La feuille de papier tient toute seule car elle se courbe quand on l’introduit dans la fente. L’objet est rempli de sable pour assurer sa stabilité. Un exemple de conception innovante.
Voici deux objets qui ont le même usage : maintenir verticale une feuille de papier. Le support de gauche est de toute évidence issu d’un bureau d’études classique. En voyant l’objet on lit dans les pensées du concepteur. « J’appuie la feuille sur une surface plane, elle repose en partie basse sur un talon. Je la maintiens en partie haute par une pince. Je stabilise le tout par une jambe de force articulée située à l’arrière. Et j’ajoute pour finir une règle transparente réglable en hauteur pour permettre une lecture ligne par ligne ». De la conception réglée, avec au final un produit cher, inutilement complexe (vous vous voyez déplacer la règle à chaque ligne ?) et fragile. L’objet de droite est d’une surprenante simplicité. La feuille de papier tient toute seule car elle se courbe quand on l’introduit dans la fente. L’objet est rempli de sable pour assurer sa stabilité. Un exemple de conception innovante.Innover n’a jamais été aussi facile
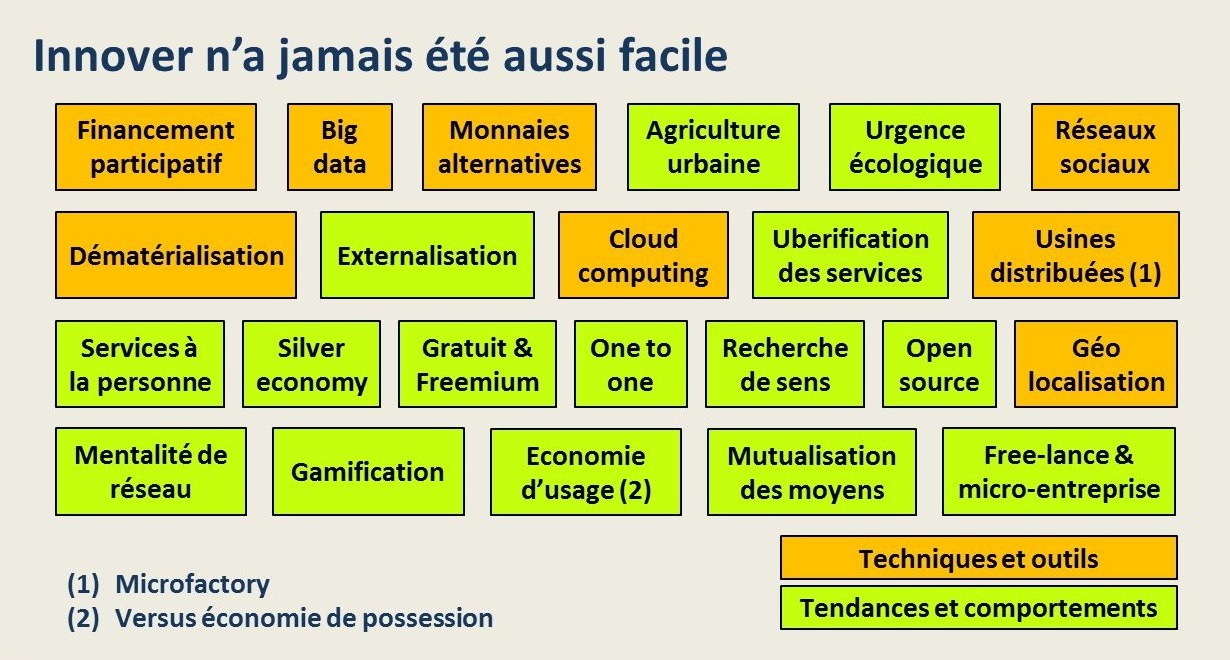 Le titre de ce paragraphe est volontairement provoquant et pourtant tellement vrai. Prenons un peu de recul et projetons-nous vingt ans en arrière. Vous vouliez publier un livre, il fallait faire accepter votre manuscrit à un éditeur. Ou investir vos économies pour éditer « à compte d’auteur ». Aujourd’hui il vous en coute le prix d’un smartphone pour le faire imprimer. Et quasiment rien pour le distribuer dans le monde entier. Vous aviez besoin d’argent pour lancer votre produit, il fallait convaincre un banquier. Aujourd’hui vous faites appel au financement participatif. On pourrait donner des dizaines d’autres exemples qui montrent à quel point l’innovation est aujourd’hui à la portée de tous.
Le titre de ce paragraphe est volontairement provoquant et pourtant tellement vrai. Prenons un peu de recul et projetons-nous vingt ans en arrière. Vous vouliez publier un livre, il fallait faire accepter votre manuscrit à un éditeur. Ou investir vos économies pour éditer « à compte d’auteur ». Aujourd’hui il vous en coute le prix d’un smartphone pour le faire imprimer. Et quasiment rien pour le distribuer dans le monde entier. Vous aviez besoin d’argent pour lancer votre produit, il fallait convaincre un banquier. Aujourd’hui vous faites appel au financement participatif. On pourrait donner des dizaines d’autres exemples qui montrent à quel point l’innovation est aujourd’hui à la portée de tous.- D’abord, un management facilitateur.
- La veille stratégique
- Fixer le cap… et éliminer les projets parasites
- Constituer et gérer un portefeuille de projets d’innovation
- Faire les choses dans le bon ordre : la matrice « ANVAR »
- Un outil indispensable : le mind-mapping
D’abord un management facilitateur
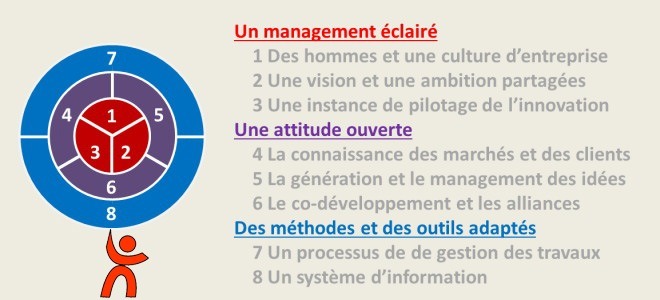 La plupart des chefs d’entreprise font la même erreur. Ils pensent (ou feignent de croire) que ce sont les outils qui résolvent les problèmes. Et en corollaire ils considèrent les individus comme des pièces interchangeables destinées à servir le process. Ce mode de pensée est toujours erroné. Et plus encore lorsqu’on est dans une démarche d’innovation. La réalité — et c’est très bien ainsi — c’est que l’innovation ne peut naître et se développer que dans un milieu ou les individus se sentent bien. Un de mes maitres disait : « on ne fait pas pousser une plante en tirant sur sa tige ». Alors si vous voulez voir naître et grandir l’innovation, préparez le terrain en bon jardinier. Concrètement mettez en pratique dans l’entreprise les préceptes de ce schéma, en commençant par le …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
La plupart des chefs d’entreprise font la même erreur. Ils pensent (ou feignent de croire) que ce sont les outils qui résolvent les problèmes. Et en corollaire ils considèrent les individus comme des pièces interchangeables destinées à servir le process. Ce mode de pensée est toujours erroné. Et plus encore lorsqu’on est dans une démarche d’innovation. La réalité — et c’est très bien ainsi — c’est que l’innovation ne peut naître et se développer que dans un milieu ou les individus se sentent bien. Un de mes maitres disait : « on ne fait pas pousser une plante en tirant sur sa tige ». Alors si vous voulez voir naître et grandir l’innovation, préparez le terrain en bon jardinier. Concrètement mettez en pratique dans l’entreprise les préceptes de ce schéma, en commençant par le …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
La veille stratégique et le projet d’innovation
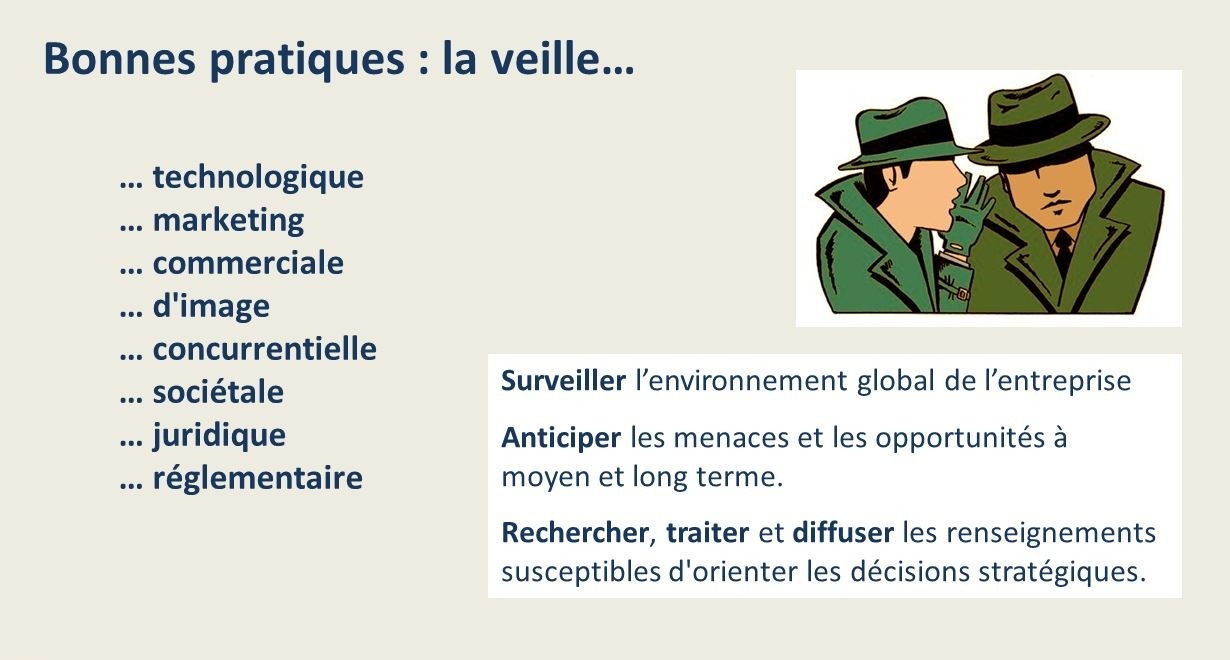 On n’innove pas seul dans son coin. Non seulement il faut avoir un état d’esprit d’ouverture mais il faut mettre en place une démarche proactive d’observation tous azimuts. C’est ce que l’on appelle une démarche de veille. Il est étonnant d’observer des industriels affairés à développer un nouveau produit et qui n’ont même pas acheté et désossé les produits des concurrents. Ou qui s’apprêtent à mettre sur le marché un produit destiné à un public qui n’existe plus ou dont les besoins ont radicalement changé. Le remède à tous ces travers, c’est la veille, d’autant plus indispensable que le monde évolue de plus en plus vite. Nous n’en dirons pas plus sur ce sujet très bien documenté sur le net.
On n’innove pas seul dans son coin. Non seulement il faut avoir un état d’esprit d’ouverture mais il faut mettre en place une démarche proactive d’observation tous azimuts. C’est ce que l’on appelle une démarche de veille. Il est étonnant d’observer des industriels affairés à développer un nouveau produit et qui n’ont même pas acheté et désossé les produits des concurrents. Ou qui s’apprêtent à mettre sur le marché un produit destiné à un public qui n’existe plus ou dont les besoins ont radicalement changé. Le remède à tous ces travers, c’est la veille, d’autant plus indispensable que le monde évolue de plus en plus vite. Nous n’en dirons pas plus sur ce sujet très bien documenté sur le net.Fixer le cap… et éliminer les projets parasites
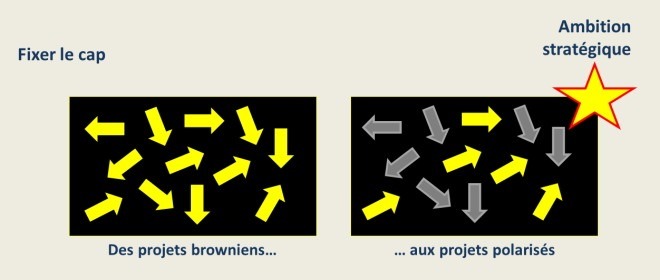 Avez-vous gardé de vos études le souvenir de ce qu’est le « mouvement brownien » ? Il s’agit du mouvement désordonné et imprévisible des molécules dans un fluide. Quel rapport avec notre propos ? Dans de nombreuses entreprises (schéma de gauche) on a la nette impression que les projets d’innovation partent dans toutes les directions, sans cohérence entre eux, comme les molécules décrites par Robert Brown il y a presque deux siècles. Il en résulte un énorme gaspillage de ressources, une grande perte d’efficacité, et souvent un grand désarroi des salariés. Que le chef d’entreprise communique sa vision (schéma de droite), qu’il fixe le cap et les choses vont mécaniquement s’améliorer. Le seul fait d’abandonner les projets d’innovation « parasites » (en gris sur le schéma) va libérer des ressources et le reste suivra.
Avez-vous gardé de vos études le souvenir de ce qu’est le « mouvement brownien » ? Il s’agit du mouvement désordonné et imprévisible des molécules dans un fluide. Quel rapport avec notre propos ? Dans de nombreuses entreprises (schéma de gauche) on a la nette impression que les projets d’innovation partent dans toutes les directions, sans cohérence entre eux, comme les molécules décrites par Robert Brown il y a presque deux siècles. Il en résulte un énorme gaspillage de ressources, une grande perte d’efficacité, et souvent un grand désarroi des salariés. Que le chef d’entreprise communique sa vision (schéma de droite), qu’il fixe le cap et les choses vont mécaniquement s’améliorer. Le seul fait d’abandonner les projets d’innovation « parasites » (en gris sur le schéma) va libérer des ressources et le reste suivra.Constituer et gérer un portefeuille de projets d’innovation
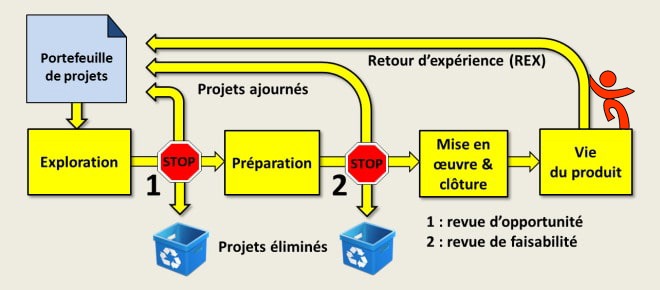 Nous parlions plus haut de « bureau des projets » et de « portefeuille de projets d’innovation ». Ce bureau des projets doit être une vraie machine à faire avancer les projets d’innovation. Le processus sur lequel il s’appuie est décrit par le croquis ci-contre. Les panneaux « STOP » correspondent à ce que l’on appelle des « jalons go/nogo ». A chaque jalon la décision est prise soit de mettre fin au projet d’innovation, soit de l’ajourner temporairement, soit de le faire passer à la phase suivante en lui affectant, bien entendu, les moyens nécessaires. Il est d’usage d’appeler revue d’opportunité le premier jalon et revue de faisabilité le second.
Nous parlions plus haut de « bureau des projets » et de « portefeuille de projets d’innovation ». Ce bureau des projets doit être une vraie machine à faire avancer les projets d’innovation. Le processus sur lequel il s’appuie est décrit par le croquis ci-contre. Les panneaux « STOP » correspondent à ce que l’on appelle des « jalons go/nogo ». A chaque jalon la décision est prise soit de mettre fin au projet d’innovation, soit de l’ajourner temporairement, soit de le faire passer à la phase suivante en lui affectant, bien entendu, les moyens nécessaires. Il est d’usage d’appeler revue d’opportunité le premier jalon et revue de faisabilité le second.Faire les choses dans le bon ordre : la matrice « ANVAR »
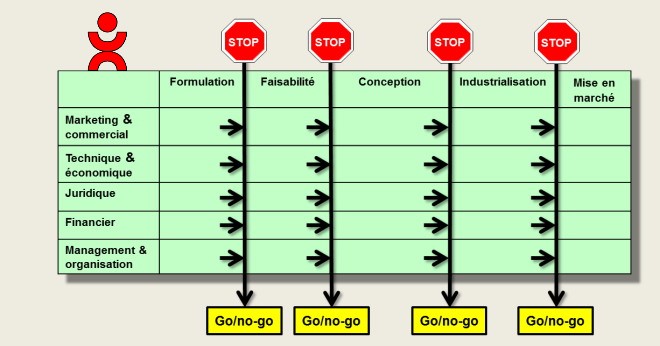 Ne me dites pas que l’ANVAR n’existe plus, je le sais… ANVAR est devenue OSEO puis Bpifrance. Bpifrance est le bras armé de l’état français pour la promotion et le financement de l’innovation. Le schéma ci-contre est à très peu de chose près celui proposé il y a quelques années par l’ANVAR, et qui continue d’être parfaitement valide aujourd’hui. Il résume la totalité du processus de projet d’innovation. En vertical figurent les domaines dans lesquels doivent porter les efforts et les investigations de l’équipe de projet. En horizontal les phases successives (le cycle de vie) de tout projet d’innovation. Tous ceux qui conseillent les entreprises ou les accompagnent dans leur démarche d’innovation s’appuient sur ce schéma pour expliquer qu’il ne faut jamais passer d’une phase à la suivante (flèches verticales) sans avoir validé les cinq domaines. Pour plus de détails vous pouvez télécharger. le tableau original ANVAR.
Ne me dites pas que l’ANVAR n’existe plus, je le sais… ANVAR est devenue OSEO puis Bpifrance. Bpifrance est le bras armé de l’état français pour la promotion et le financement de l’innovation. Le schéma ci-contre est à très peu de chose près celui proposé il y a quelques années par l’ANVAR, et qui continue d’être parfaitement valide aujourd’hui. Il résume la totalité du processus de projet d’innovation. En vertical figurent les domaines dans lesquels doivent porter les efforts et les investigations de l’équipe de projet. En horizontal les phases successives (le cycle de vie) de tout projet d’innovation. Tous ceux qui conseillent les entreprises ou les accompagnent dans leur démarche d’innovation s’appuient sur ce schéma pour expliquer qu’il ne faut jamais passer d’une phase à la suivante (flèches verticales) sans avoir validé les cinq domaines. Pour plus de détails vous pouvez télécharger. le tableau original ANVAR.- La créativité individuelle : cerveau droit, cerveau gauche
- Le processus créatif selon Graham Wallas
- Les qualités du sujet créatif
- Où êtes-vous créatif ?
- De l’angoisse cartésienne aux tueurs d’idées
- Le brainstorming… et ses limites
- Le processus collectif de production d’idées
- Un outil indispensable : le mind-mapping
- D’abord, la purge
- Puis l’analyse défectuologique
- Les outils d’animation
- Les 9 écrans
- Comment sélectionner les idées
La créativité individuelle : cerveau droit, cerveau gauche
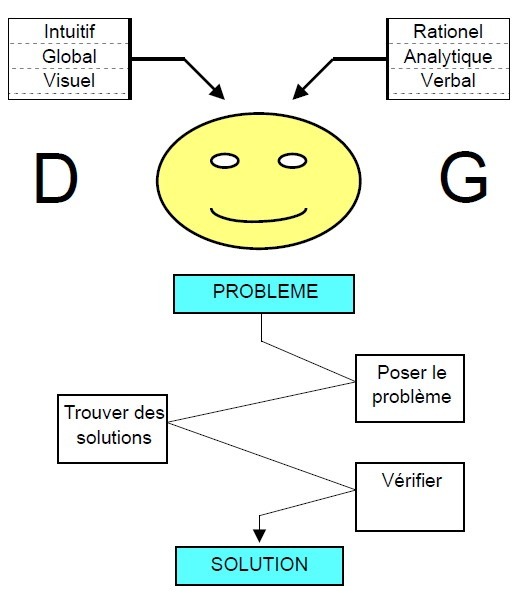 Le fait que nos deux hémisphères cérébraux soient spécialisés est une chose communément admise. Notre hémisphère cérébral gauche serait le siège de la parole et de la logique déductive. L’hémisphère droit serait celui de la vision, de l’intuition et de la création artistique. De nombreux scientifiques, et notamment Einstein le plus célèbre d’entre eux, ont théorisé le fait que le processus créatif nécessite la mobilisation, alternativement, des deux capacités cérébrales, logique et intuitive. De par notre naissance et du fait de notre éducation, la plupart d’entre nous utilisent préférentiellement l’un de leurs deux hémisphères cérébraux. En France, les élèves et étudiants des filières scientifiques et techniques sont des hémiplégiques droits, tant les programmes privilégient les sciences dures et la logique déductive. De ces constats on peut tirer plusieurs principes d’action. A titre individuel, nous avons tous à faire confiance et à entrainer notre hémisphère orphelin. En matière de créativité collective, prenons garde lorsqu’on constitue un groupe de travail que les deux typologies y soient représentées. Un groupe formé de seuls rationnels produira probablement des solutions convenues (peu ou pas innovantes) et il y a de forts risques que le résultat soit compliqué, cher et peu satisfaisant pour l’utilisateur. A l’inverse un groupe de purs créatifs risque de ne rien produire de concret.
Le fait que nos deux hémisphères cérébraux soient spécialisés est une chose communément admise. Notre hémisphère cérébral gauche serait le siège de la parole et de la logique déductive. L’hémisphère droit serait celui de la vision, de l’intuition et de la création artistique. De nombreux scientifiques, et notamment Einstein le plus célèbre d’entre eux, ont théorisé le fait que le processus créatif nécessite la mobilisation, alternativement, des deux capacités cérébrales, logique et intuitive. De par notre naissance et du fait de notre éducation, la plupart d’entre nous utilisent préférentiellement l’un de leurs deux hémisphères cérébraux. En France, les élèves et étudiants des filières scientifiques et techniques sont des hémiplégiques droits, tant les programmes privilégient les sciences dures et la logique déductive. De ces constats on peut tirer plusieurs principes d’action. A titre individuel, nous avons tous à faire confiance et à entrainer notre hémisphère orphelin. En matière de créativité collective, prenons garde lorsqu’on constitue un groupe de travail que les deux typologies y soient représentées. Un groupe formé de seuls rationnels produira probablement des solutions convenues (peu ou pas innovantes) et il y a de forts risques que le résultat soit compliqué, cher et peu satisfaisant pour l’utilisateur. A l’inverse un groupe de purs créatifs risque de ne rien produire de concret.Le processus créatif selon Graham Wallas
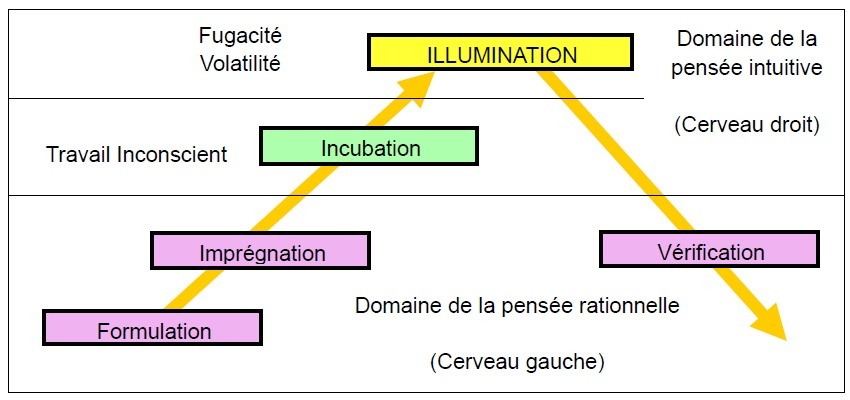 Graham Wallas a modélisé le processus créatif. Le schéma ci-contre est une représentation de ce processus, de gauche à droite. D’abord prenons garde à une bonne formulation le problème. Citons encore Einstein : « un problème insoluble est un problème mal posé ». Pour aller un peu plus loin, on pourrait dire « un problème insoluble est un problème qui n’est pas posé au bon niveau systémique ». Une fois le problème correctement formulé, commence la phase d’imprégnation : on se documente sur le domaine du projet d’innovation (merci Google !). Si l’on est dans une démarche collective les membres de l’équipe en discutent, confrontent leurs points de vue. Tout ce qui précède est du domaine du conscient et de la logique. Le principal apport de Wallas est …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
Graham Wallas a modélisé le processus créatif. Le schéma ci-contre est une représentation de ce processus, de gauche à droite. D’abord prenons garde à une bonne formulation le problème. Citons encore Einstein : « un problème insoluble est un problème mal posé ». Pour aller un peu plus loin, on pourrait dire « un problème insoluble est un problème qui n’est pas posé au bon niveau systémique ». Une fois le problème correctement formulé, commence la phase d’imprégnation : on se documente sur le domaine du projet d’innovation (merci Google !). Si l’on est dans une démarche collective les membres de l’équipe en discutent, confrontent leurs points de vue. Tout ce qui précède est du domaine du conscient et de la logique. Le principal apport de Wallas est …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
Les qualités du sujet créatif
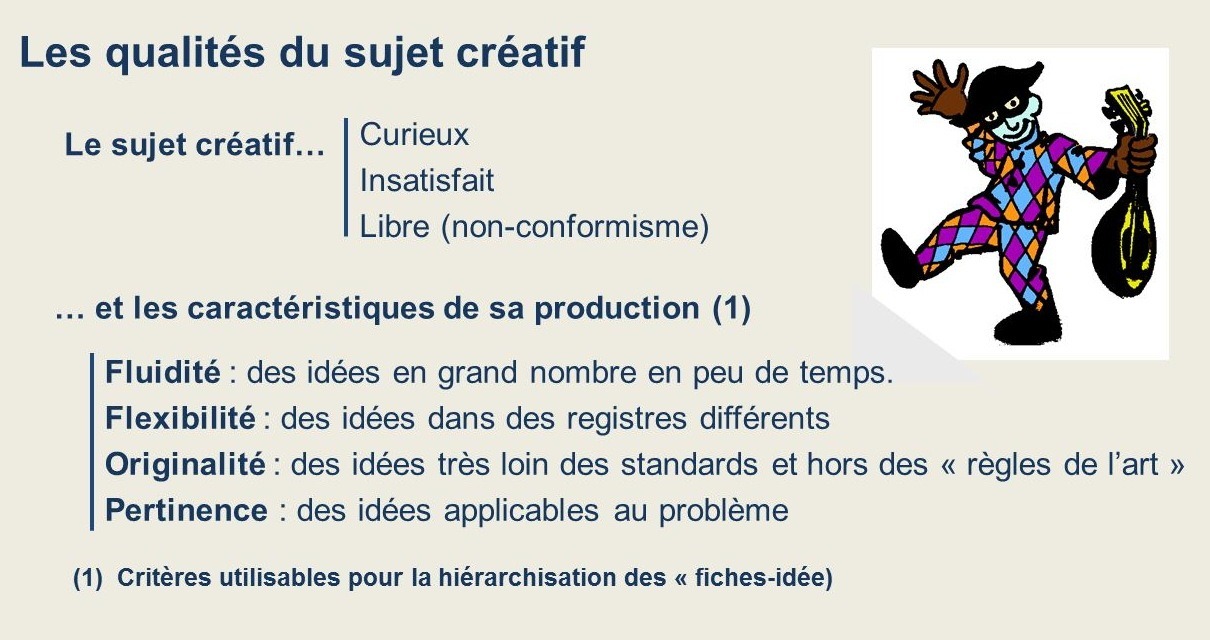 Nous sommes inégalement créatifs, mais à quoi reconnait-on un individu créatif ?
Nous sommes inégalement créatifs, mais à quoi reconnait-on un individu créatif ?– Il est curieux. Enfant il cassait ses jouets pour en découvrir l’intérieur. Devenu adulte il ne jette pas un objet sans l’avoir démonté. Au restaurant il demande au cuisinier la composition d’un plat. Au musée ou en visite chez un artisan il pose sans cesse des questions. Et comme il retient tout il a acquis au fil du temps et sans efforts une grande culture technique.
– C’est un éternel insatisfait. Pas un grincheux ni un pessimiste. Il est insatisfait parce que les produits qu’il achète et les services auxquels il souscrit ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Il est conscient que les ingénieurs peuvent mieux faire et il leur reproche de ne pas l’avoir fait. Et il est convaincu que les produits de demain seront meilleurs que ceux d’aujourd’hui, mais il trouve que cela ne vient pas assez vite.
– En politique il déteste la pensée unique, il détecte comme personne la langue de bois. Dans la vie professionnelle il se méfie comme de la peste des habitudes, des standards, des « règles de l’art ». C’est le champion de l' »idéalité » cette méthode (décrite plus loin dans ce chapitre) qui consiste à imaginer et décrire le produit ou le service idéal.
Où etes-vous créatif ?
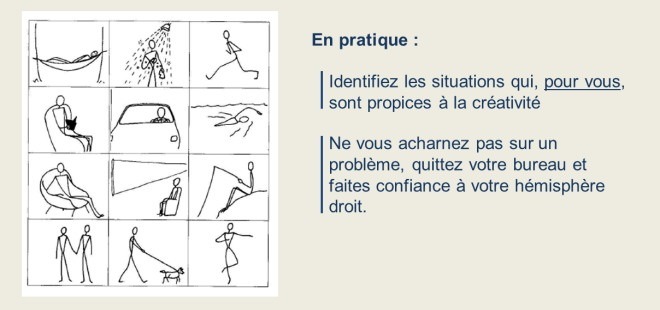 Nous avons vu plus haut que l’illumination survient assez systématiquement dans des moments de détente mentale. Voici un petit exercice (extrait de l’ouvrage « Trouvez les idées qui gagnent » édité aux presses du management) que vous pouvez faire seul ou en groupe. Les 12 dessins correspondent à 12 situations de la vie courante. Il est fort probable que vous reconnaissiez dans l’une ou l’autre de ces situations à une activité qui favorise chez vous la créativité. L’expérimentation sur des dizaines de groupes a montré que la moitié des individus environ reconnait immédiatement la situation dans laquelle il se sent créatif. Si c’est votre cas la leçon à en tirer est simple : lorsque vous devez faire preuve de créativité pour produire des idées ou tout simplement résoudre un problème, quittez votre bureau, munissez-vous d’un moyen d’enregistrer votre production, isolez-vous dans votre activité créative et laissez faire.
Nous avons vu plus haut que l’illumination survient assez systématiquement dans des moments de détente mentale. Voici un petit exercice (extrait de l’ouvrage « Trouvez les idées qui gagnent » édité aux presses du management) que vous pouvez faire seul ou en groupe. Les 12 dessins correspondent à 12 situations de la vie courante. Il est fort probable que vous reconnaissiez dans l’une ou l’autre de ces situations à une activité qui favorise chez vous la créativité. L’expérimentation sur des dizaines de groupes a montré que la moitié des individus environ reconnait immédiatement la situation dans laquelle il se sent créatif. Si c’est votre cas la leçon à en tirer est simple : lorsque vous devez faire preuve de créativité pour produire des idées ou tout simplement résoudre un problème, quittez votre bureau, munissez-vous d’un moyen d’enregistrer votre production, isolez-vous dans votre activité créative et laissez faire.De l’angoisse cartésienne aux tueurs d’idées
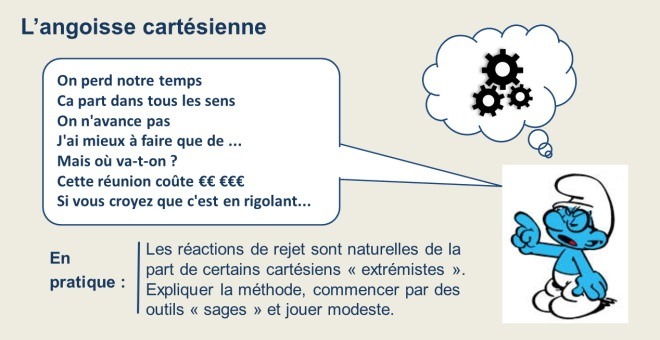 Dans une entreprise ou toute autre organisme structuré sur un modèle classique c’est à dire hiérarchique et procédurier, réunir pour la première fois un groupe de recherche d’idées c’est s’exposer au tir de barrage des « cerveaux gauches », rationalistes, déroutés par le fait d’avancer en terrain inconnu. Leur état mental, résumé par l’expression « angoisse cartésienne » se traduit par des réactions hostiles, voire violentes et des remarques sarcastiques comme celles du schéma ci-contre. Ces réactions sont normales et il faut les prendre comme telles. Néanmoins il n’est pas facile d’amener ces participants à rentrer dans le jeu de la réunion créative, caractérisée par l’improvisation, l’humour, l’absence apparente de fil conducteur et de démarche rigoureuse.
Dans une entreprise ou toute autre organisme structuré sur un modèle classique c’est à dire hiérarchique et procédurier, réunir pour la première fois un groupe de recherche d’idées c’est s’exposer au tir de barrage des « cerveaux gauches », rationalistes, déroutés par le fait d’avancer en terrain inconnu. Leur état mental, résumé par l’expression « angoisse cartésienne » se traduit par des réactions hostiles, voire violentes et des remarques sarcastiques comme celles du schéma ci-contre. Ces réactions sont normales et il faut les prendre comme telles. Néanmoins il n’est pas facile d’amener ces participants à rentrer dans le jeu de la réunion créative, caractérisée par l’improvisation, l’humour, l’absence apparente de fil conducteur et de démarche rigoureuse.Fort heureusement les cas pathologiques sont rares. Si c’est le cas il ne faut pas hésiter à exclure l’irréductible en l’invitant à revenir à ses occupations « rationnelles »
Reste que l’animateur va devoir faire fonctionner des individus dans un registre qui ne leur est pas habituel. La production d’idées ne peut se faire que dans un contexte détendu et convivial. Les outils de créativité sont le plus souvent…….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
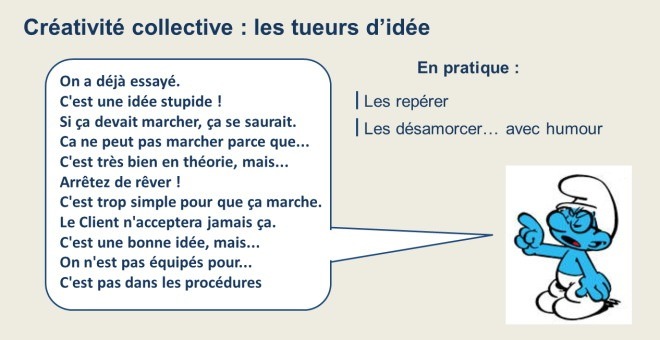 Quel jeune diplômé fraichement embauché, fort de son enthousiasme et portant un regard neuf sur l’entreprise, proposant une bonne idée à son supérieur ou a ses collègues n’a pas été douché par une réponse du type : « C’est très bien en théorie, mais… » ou encore « Tu penses bien qu’on y a déjà pensé… »Le phénomène est si fréquent et si connu que la littérature technique fourmille de listes de ces phrases « tueuses d’idées ». Vous êtres jeune ? ne vous laissez pas déstabiliser par ces phrases toutes faites, c’est vous qui êtes dans le vrai. Pire que cela dépêchez-vous d’agir car dans quelques années vous serez rentré dans le moule et c’est vous qui sans même vous en rendre compte bloquerez les nouveaux à coup de phrases tueuses. Même si c’est injuste l’innovation vient le plus souvent de celui qui n’a qu’une connaissance superficielle du domaine.
Quel jeune diplômé fraichement embauché, fort de son enthousiasme et portant un regard neuf sur l’entreprise, proposant une bonne idée à son supérieur ou a ses collègues n’a pas été douché par une réponse du type : « C’est très bien en théorie, mais… » ou encore « Tu penses bien qu’on y a déjà pensé… »Le phénomène est si fréquent et si connu que la littérature technique fourmille de listes de ces phrases « tueuses d’idées ». Vous êtres jeune ? ne vous laissez pas déstabiliser par ces phrases toutes faites, c’est vous qui êtes dans le vrai. Pire que cela dépêchez-vous d’agir car dans quelques années vous serez rentré dans le moule et c’est vous qui sans même vous en rendre compte bloquerez les nouveaux à coup de phrases tueuses. Même si c’est injuste l’innovation vient le plus souvent de celui qui n’a qu’une connaissance superficielle du domaine.Les tueurs d’idées sont de grands classiques des réunions de recherche d’idées. Le stress, la routine, les préjugés, les tensions, les inimitiés, les rivalités, le pessimisme, tous ces facteurs vont amener certains participants à se montrer systématiquement négatifs vis-à vis des idées émises. Comment éviter les tueurs d’idées lors d’une réunion de recherche d’idées ? C’est extrêmement simple : Commencez la réunion de projet d’innovation en affichant la liste des tueurs d’idées. Vous n’aurez plus rien à faire ensuite, c’est les participants eux-mêmes qui feront la police. Et il est fort probable que cette chasse aux tueurs d’idées contribue à l’ambiance ludique nécessaire à la créativité.
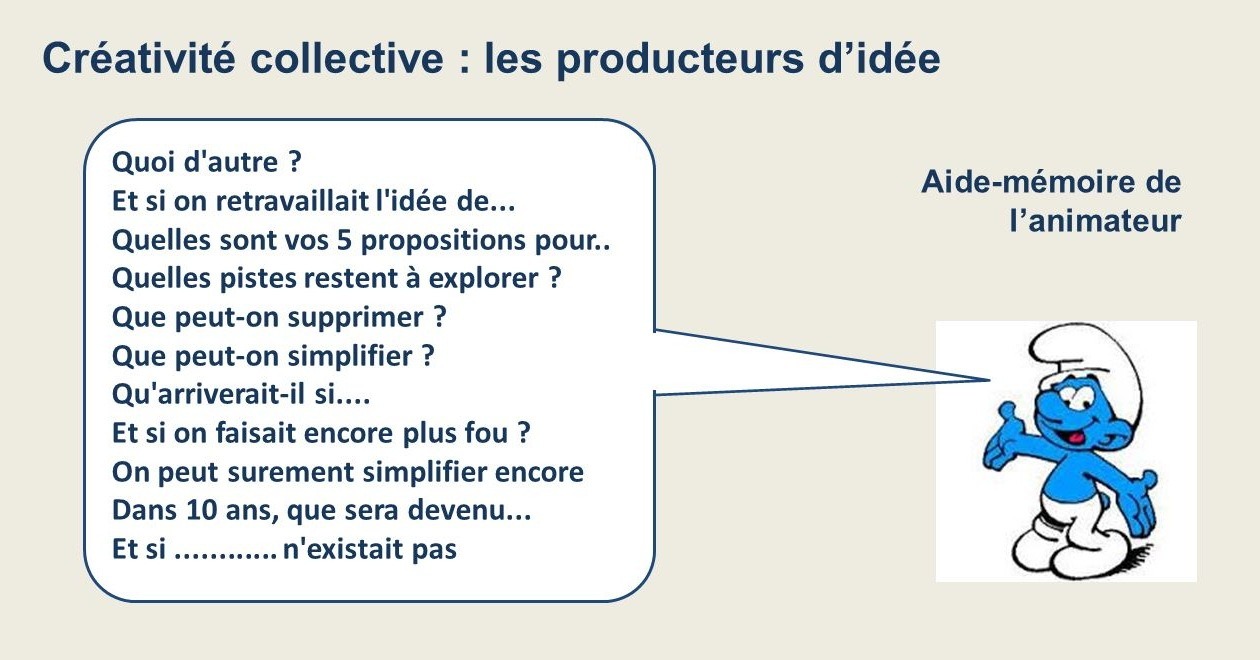 Vous animez des réunions de créativité ? Alors vous avez probablement vécu douloureusement ces longs moments de silence où plus aucun participant ne s’exprime, et où vos « alors, plus d’idées ? » ne font que renforcer le malaise. La solution, c’est d’abord de supprimer de votre vocabulaire les « plus d’idées ? » « pas d’autre proposition ? » et autres formes négatives qui sont interprétées par le cerveau de vos interlocuteurs comme des injonctions : « (je ne veux) plus d’idées », « (je ne veux) pas d’autres propositions ». Ensuite faites-vous une liste de formules positives de relance, comme celle qui figure ci-contre, et apprenez-la par cœur. Vous casserez désormais les silences avec une invitation à changer de piste de recherche.
Vous animez des réunions de créativité ? Alors vous avez probablement vécu douloureusement ces longs moments de silence où plus aucun participant ne s’exprime, et où vos « alors, plus d’idées ? » ne font que renforcer le malaise. La solution, c’est d’abord de supprimer de votre vocabulaire les « plus d’idées ? » « pas d’autre proposition ? » et autres formes négatives qui sont interprétées par le cerveau de vos interlocuteurs comme des injonctions : « (je ne veux) plus d’idées », « (je ne veux) pas d’autres propositions ». Ensuite faites-vous une liste de formules positives de relance, comme celle qui figure ci-contre, et apprenez-la par cœur. Vous casserez désormais les silences avec une invitation à changer de piste de recherche.Le brainstorming… et ses limites
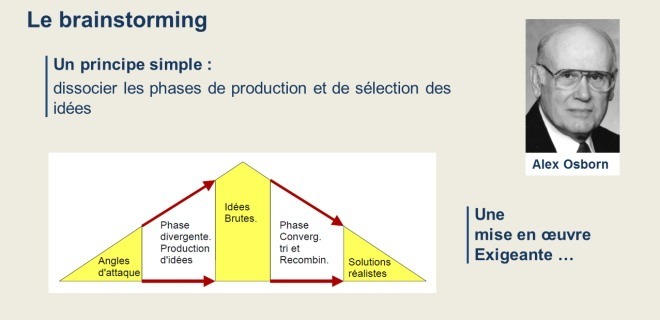 Beaucoup d’enseignants et bien plus largement la plupart des gens assimilent la créativité au brainstorming. Nous ne tomberons pas dans cette vision simplificatrice mais c’est dire l’importance majeure de cet outil.
Beaucoup d’enseignants et bien plus largement la plupart des gens assimilent la créativité au brainstorming. Nous ne tomberons pas dans cette vision simplificatrice mais c’est dire l’importance majeure de cet outil.Un peu d’histoire : Dans les années 1930, Alex Osborn, président de l’agence de publicité Newyorkaise BBDO constate que les réunions de recherche d’idées sont peu productives. Il décide de dissocier la phase de production d’idées de la phase de tri. Il édicte quelques règles dont voici la liste :
Les règles du brainstorming
Ne pas critiquer
Ne pas s’autocensurer
Piller les idées des autres
Énoncer des phrases courtes, sans développement ni justification
Le secrétaire (ou l’animateur) note toutes les idées émises sur le paperboard
Tout ce qui a été écrit reste à la vue des participants.
Le choix du lieu, l’organisation
Les réunions de recherche d’idées doivent de préférence avoir lieu …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
Le processus collectif de production d’idées
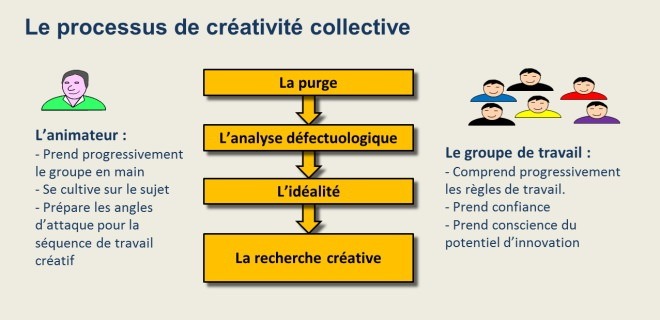 Imaginer que le processus créatif se limite au brainstorming est une erreur qui explique à elle seule bien des échecs. La démarche créative nécessite de dérouler plusieurs outils dans un ordre bien précis, comme indiqué dans le schéma ci-contre. Nous allons décrire un peu plus loin ces différents outils que sont la purge, l’analyse défectuologique, l’idéalité puis la recherche créative.
Imaginer que le processus créatif se limite au brainstorming est une erreur qui explique à elle seule bien des échecs. La démarche créative nécessite de dérouler plusieurs outils dans un ordre bien précis, comme indiqué dans le schéma ci-contre. Nous allons décrire un peu plus loin ces différents outils que sont la purge, l’analyse défectuologique, l’idéalité puis la recherche créative.Un outil indispensable du projet d’innovation le mind-mapping
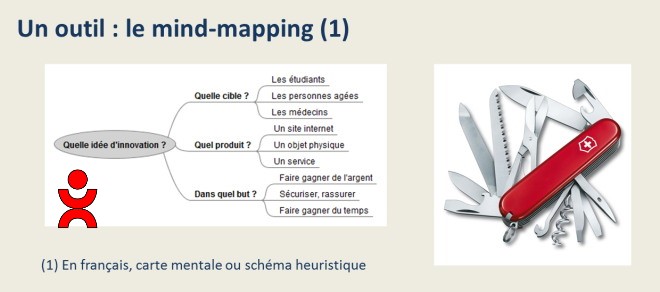 Avant de décrire en détail les étapes du processus créatif, le moment est venu de vous présenter un outil fort utile dans la démarche de projet d’innovation et dans bien d’autres situations.
Avant de décrire en détail les étapes du processus créatif, le moment est venu de vous présenter un outil fort utile dans la démarche de projet d’innovation et dans bien d’autres situations.Si vous ne connaissez pas encore le mind-mapping (en français carte mentale ou schéma heuristique), ne restez pas plus longtemps dans l’ignorance ! Téléchargez Freeplane (gratuit) ou l’un de ses équivalents, tous excellents, et passez une heure à le découvrir. Il serait bien étonnant que vous ne l’adoptiez pas. Le mind-mapping est tout aussi utile en solo, pour organiser sa pensée, qu’en animation de réunion. Si le mind-mapping existait bien avant les logiciels qui le mettent en œuvre, ces derniers en ont décuplé la performance. Les utilisations du mind-mapping sont multiples : préparer un exposé, animer une réunion, structurer un projet, organiser son travail ou celui de l’équipe. Et surtout animer une réunion de brainstorming.
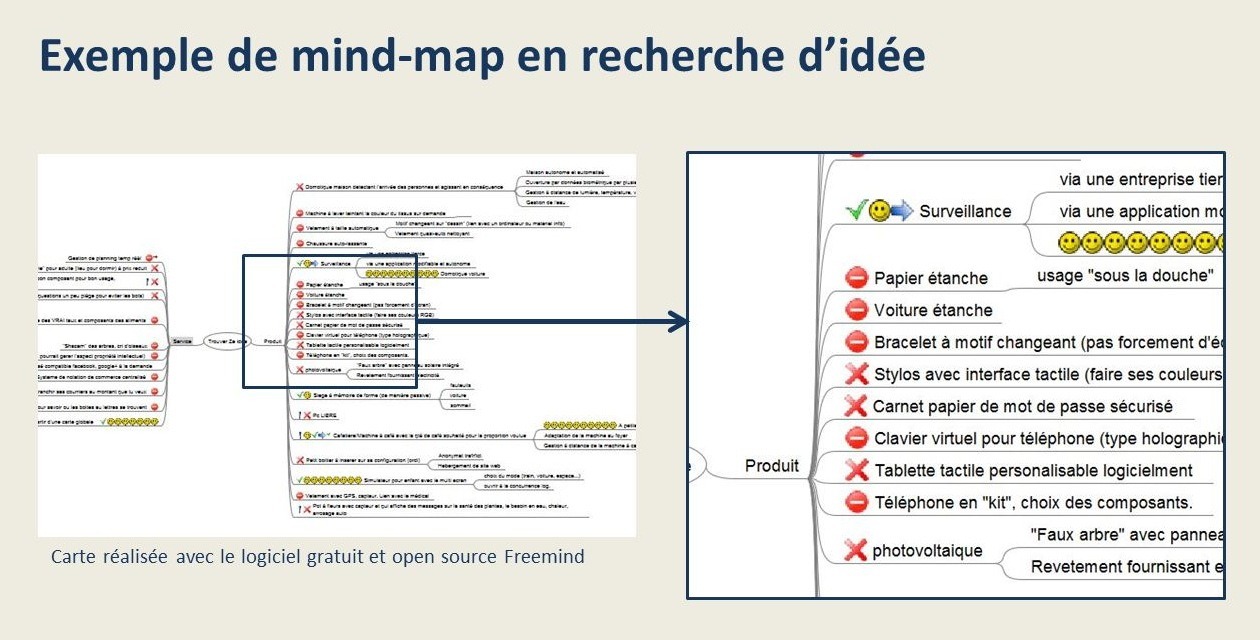 Voici ci-contre un exemple d’utilisation d’un logiciel de mind-mapping (Freeplane). Cette carte mentale a été réalisée en deux heures de travail par un groupe de trois personnes, avec comme objectif de trouver une idée d’innovation. Observez le foisonnement d’idées qui aurait été impossible sans support visuel. Voyez comment les idées sont organisées pat thème, la réorganisation en temps réel est d’une facilité déconcertante. Remarquez l’utilisation intelligente des icônes pour marquer les idées sans intérêt (mais qu’il faut conserver car une mauvaise idée peut en inspirer une bonne) et pour signaler les pistes à creuser.
Voici ci-contre un exemple d’utilisation d’un logiciel de mind-mapping (Freeplane). Cette carte mentale a été réalisée en deux heures de travail par un groupe de trois personnes, avec comme objectif de trouver une idée d’innovation. Observez le foisonnement d’idées qui aurait été impossible sans support visuel. Voyez comment les idées sont organisées pat thème, la réorganisation en temps réel est d’une facilité déconcertante. Remarquez l’utilisation intelligente des icônes pour marquer les idées sans intérêt (mais qu’il faut conserver car une mauvaise idée peut en inspirer une bonne) et pour signaler les pistes à creuser.D’abord, la purge
La « purge » consiste tout simplement à faire énoncer par chacun des participants, avant toute séquence de créativité, les idées de solutions qu’il a en tête. Bien que très simple, cet outil est un passage obligé et comme nous allons le voir doit être conduit avec méthode.
Dans un esprit de rigueur scientifique, il est bon de faire la différence entre les idées qui existaient avant la démarche créative et celles réellement produites par le groupe. Notons que le participant garde la paternité des idées qu’il a émis avant la séquence créative. A l’inverse une idée produite en travail groupe est la production du groupe et non de celui qui l’a énoncée.
La purge permet aux participants…….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
Puis l’analyse défectuologique
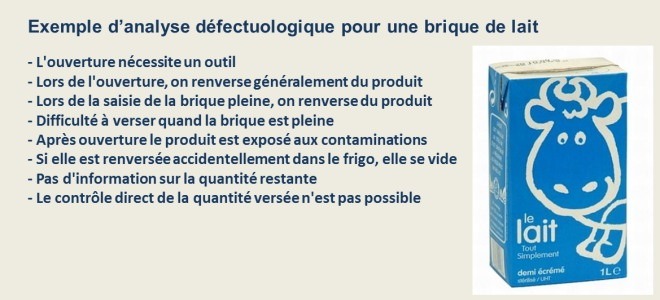 L’Analyse défectuologique est un outil aussi utile et puissant que peu connu. C’est une démarche de repérage systématique des défauts (d’où le terme barbare « défectuologique ») inhérents à un objet ou à un procédé. Elle consiste à dresser la liste des dysfonctionnements connus et des insatisfactions constatées. La méthode trouve la pleine puissance lorsqu’un groupe de travail est en charge de re-concevoir le produit de l’entreprise.
L’Analyse défectuologique est un outil aussi utile et puissant que peu connu. C’est une démarche de repérage systématique des défauts (d’où le terme barbare « défectuologique ») inhérents à un objet ou à un procédé. Elle consiste à dresser la liste des dysfonctionnements connus et des insatisfactions constatées. La méthode trouve la pleine puissance lorsqu’un groupe de travail est en charge de re-concevoir le produit de l’entreprise.Intérêt de la méthode
Pratiquée au tout début de la démarche de projet d’innovation, l’analyse défectuologique présente comme avantages objectifs :
– De trouver quelques fonctions du Cahier des charges fonctionnel (CDCF), par simple inversion des défauts énoncés
– De fournir des angles d’attaque pour les premières pistes d’amélioration.
– D’isoler les problèmes faciles à traiter, afin de réserver les méthodes lourdes aux problèmes récalcitrants.
Il ne faut pas sous-estimer les avantages induits en terme d’animation du groupe de recherche d’idées La séquence d’analyse défectuologique permet :
– De construire la dynamique de groupe en utilisant un outil facile à manipuler et dont on est certain qu’il produira des résultats.
– De commencer à faire fonctionner le groupe sur le mode libre, voire ludique indispensable pour une bonne production d’idées.
– Si le produit étudié est le produit actuel de l’entreprise, de casser « l’attachement affectif » des membres du groupe pour le produit, et cela de la meilleure façon possible puisque ce sont les participants et non l’animateur qui vont dévaloriser le produit. Précisons que l’animateur, surtout s’il est étranger à l’entreprise, doit s’interdire de formuler des critiques sur le produit.
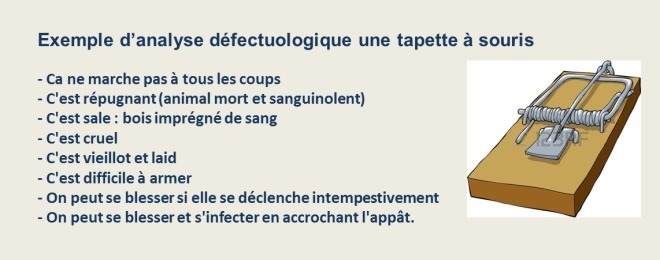 Pour illustrer le propos, voici deux exemples d’analyses défectuologique. Ce travail a été réalisé par des groupes d’étudiants, la déontologie m’interdisant de citer des cas réels d’entreprises clientes. Ci-dessus l’exemple d’une brique de lait et ci-contre celui d’une tapette à souris. Aviez-vous vu ces produits sous cet angle ? Nul doute qu’après ce travail une équipe de projet d’innovation serait motivée pour faire évoluer le produit et disposerait d’un bon nombre de pistes d’amélioration. Et si vous vous entrainiez à porter un regard critique sur les objets qui vous entourent !
Pour illustrer le propos, voici deux exemples d’analyses défectuologique. Ce travail a été réalisé par des groupes d’étudiants, la déontologie m’interdisant de citer des cas réels d’entreprises clientes. Ci-dessus l’exemple d’une brique de lait et ci-contre celui d’une tapette à souris. Aviez-vous vu ces produits sous cet angle ? Nul doute qu’après ce travail une équipe de projet d’innovation serait motivée pour faire évoluer le produit et disposerait d’un bon nombre de pistes d’amélioration. Et si vous vous entrainiez à porter un regard critique sur les objets qui vous entourent !Les outils d’animation de projet d’innovation
Il existe une quantité surprenante d’outils d’animation susceptibles d’être utilisés en séance de recherche d’idées. Ces outils se répartissent dans les 6 familles ci-dessous. Ces méthodes sont présentées par ordre d’acceptabilité décroissante : d’abord les méthodes facilement acceptables par des participants rationalistes, puis celles plus efficaces mais qui peuvent dérouter un public débutant en créativité. Enfin les méthodes extrêmes réservées aux « créatifs » de métier.
Les démarches combinatoires
– Principe : Identifier une, deux séries ou plus de paramètres caractéristiques du problème, puis croiser ou combiner ces éléments de façon systématiques. Ces méthodes offrent l’avantage de rassurer les « cerveaux gauches » habitués à construire et manipuler des tableaux de valeurs.
– Méthodes : La matrice carrée. La matrice rectangulaire. L’analyse morphologique (Fritz Zwicky)
Les démarches Associatives
– Principe : Progresser par associations d’idées à partir d’une première formulation du problème. Les méthodes associatives offrent l’avantage d’être connues. Certains les confondent avec le brainstorming. L’intérêt des méthodes associatives est de familiariser les participants avec le …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
Les 9 écrans
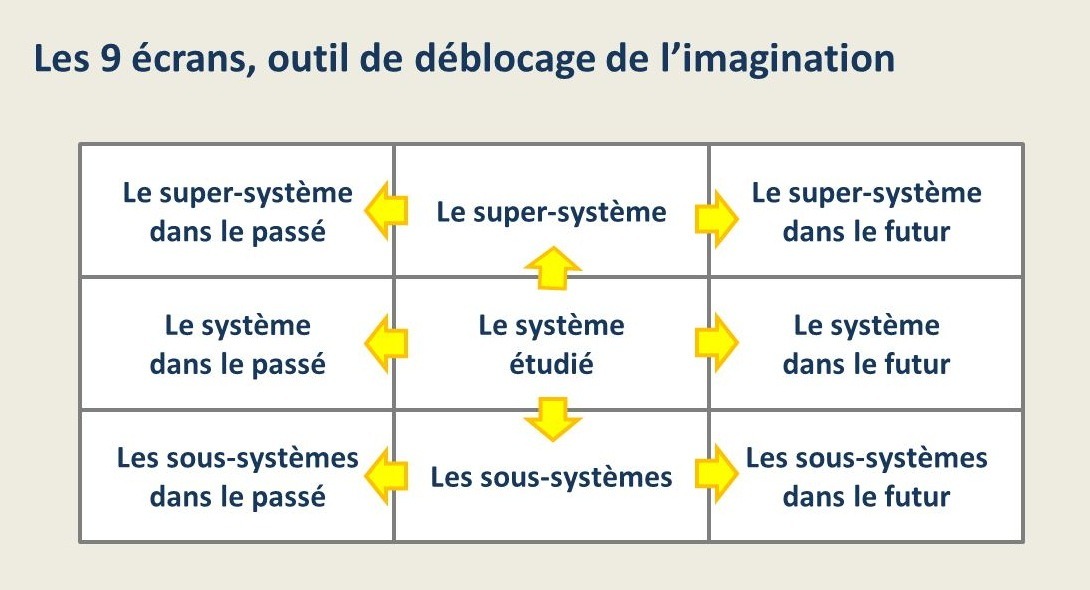 Voici un outil d’animation tiré de la méthode Triz : Les 9 écrans. Cet outil est à utiliser en tout début de recherche créative. Son principal intérêt est d’élargir le champ mental des participants. La grille de travail est une matrice 3 x 3. La case centrale est dédiée au système objet de l’étude (produit, service…). Les participants sont invités à travailler en premier dans la colonne centrale qui est celle du temps présent. Ils doivent décrire successivement les parties constitutives (les sous-systèmes) et le domaine auquel appartient l’objet de l’étude (le super système). L’animateur centre ensuite l’attention sur le lointain passé. Quel système était utilisé dans le passé en lieu et place de celui que nous connaissons aujourd’hui, qu’était le super système et quels étaient les sous systèmes. Vient ensuite la phase réellement créative qui consiste à se projeter dans l’avenir pour imaginer et décrire successivement le système futur, ses sous-systèmes et le super système auquel il appartiendra.
Voici un outil d’animation tiré de la méthode Triz : Les 9 écrans. Cet outil est à utiliser en tout début de recherche créative. Son principal intérêt est d’élargir le champ mental des participants. La grille de travail est une matrice 3 x 3. La case centrale est dédiée au système objet de l’étude (produit, service…). Les participants sont invités à travailler en premier dans la colonne centrale qui est celle du temps présent. Ils doivent décrire successivement les parties constitutives (les sous-systèmes) et le domaine auquel appartient l’objet de l’étude (le super système). L’animateur centre ensuite l’attention sur le lointain passé. Quel système était utilisé dans le passé en lieu et place de celui que nous connaissons aujourd’hui, qu’était le super système et quels étaient les sous systèmes. Vient ensuite la phase réellement créative qui consiste à se projeter dans l’avenir pour imaginer et décrire successivement le système futur, ses sous-systèmes et le super système auquel il appartiendra.Comment sélectionner les idées
Le tri des idées est une phase délicate, le risque étant d’éliminer trop vite une idée jugée irréaliste ou carrément farfelue. Rien ne ressemble plus à une idée géniale qu’une idée stupide. La grille ci-dessous donne des indication pour la notation des fiches idée. On ne peut que conseiller de pondérer fortement la note d’originalité.
Critère d’originalité
1- Proposition classique évidente
2- Proposition inspirée de solutions courantes
3- Proposition en partie innovante
4- Proposition totalement inédite
Critère d’efficacité
1- Résout peu ou pas le problème posé
2- Résout partiellement le problème
3- Répond largement au problème posé
4- Répond parfaitement au problème
Critère de faisabilité
1- Paraît très difficile à mettre en œuvre
2- Peu facile à réaliser
3- Faisable en grande partie
4- Réalisable sans difficulté
Les idées retenues à l’issue de la séance de tri donneront lieu à vérification par des essais, tests, maquettes ou tout autre moyen de façon à en tirer des solutions possibles.
- Le syndrome du réverbère
- Les miroirs aux alouettes ou le cycle de Gartner
- Comment reconnaitre le « bon projet d’innovation »
- De l’idée au projet d’innovation
- Sélectionner les projets d’innovation avec la matrice d’attractivité
- Démontrer la rentabilité de l’investissement
Le syndrome du réverbère
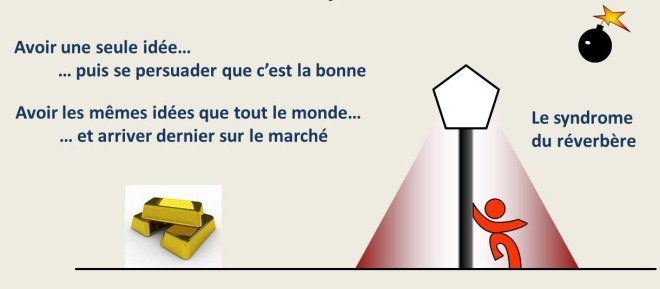 Connaissez-vous l’histoire de cet homme qui cherchait son trousseau de clés, de nuit, sous un réverbère. Un promeneur s’approche et propose son aide. Le trousseau de clés reste introuvable. Au bout d’un moment le promeneur pose la question « êtes-vous certain de l’avoir perdu sous ce réverbère ? « Pas du tout, » répond le premier. « je cherche ici parce que c’est le seul endroit où il y a de la lumière ». Cette histoire illustre de façon métaphorique le travers de beaucoup d’entreprises à la recherche d’un projet d’innovation. Elles cherchent dans le domaine qu’elles connaissent bien (sous le réverbère). Moyennant quoi elles passent à coté d’opportunités qui étaient pourtant à leur portée.
Connaissez-vous l’histoire de cet homme qui cherchait son trousseau de clés, de nuit, sous un réverbère. Un promeneur s’approche et propose son aide. Le trousseau de clés reste introuvable. Au bout d’un moment le promeneur pose la question « êtes-vous certain de l’avoir perdu sous ce réverbère ? « Pas du tout, » répond le premier. « je cherche ici parce que c’est le seul endroit où il y a de la lumière ». Cette histoire illustre de façon métaphorique le travers de beaucoup d’entreprises à la recherche d’un projet d’innovation. Elles cherchent dans le domaine qu’elles connaissent bien (sous le réverbère). Moyennant quoi elles passent à coté d’opportunités qui étaient pourtant à leur portée.Choisir le bon projet d’innovation c’est d’abord faire preuve de créativité en faisant une exploration aussi large que possible des domaines dans lesquels notre savoir-faire peut trouver à s’exprimer. Comment ? en mettant en œuvre les principes, les techniques et les outils de la créativité. Il sont décrits dans une leçon précédente. Maintenant que vous connaissez le syndrome du réverbère, ne vous laissez plus prendre.
Les miroirs aux alouettes ou le hype cycle de Gartner
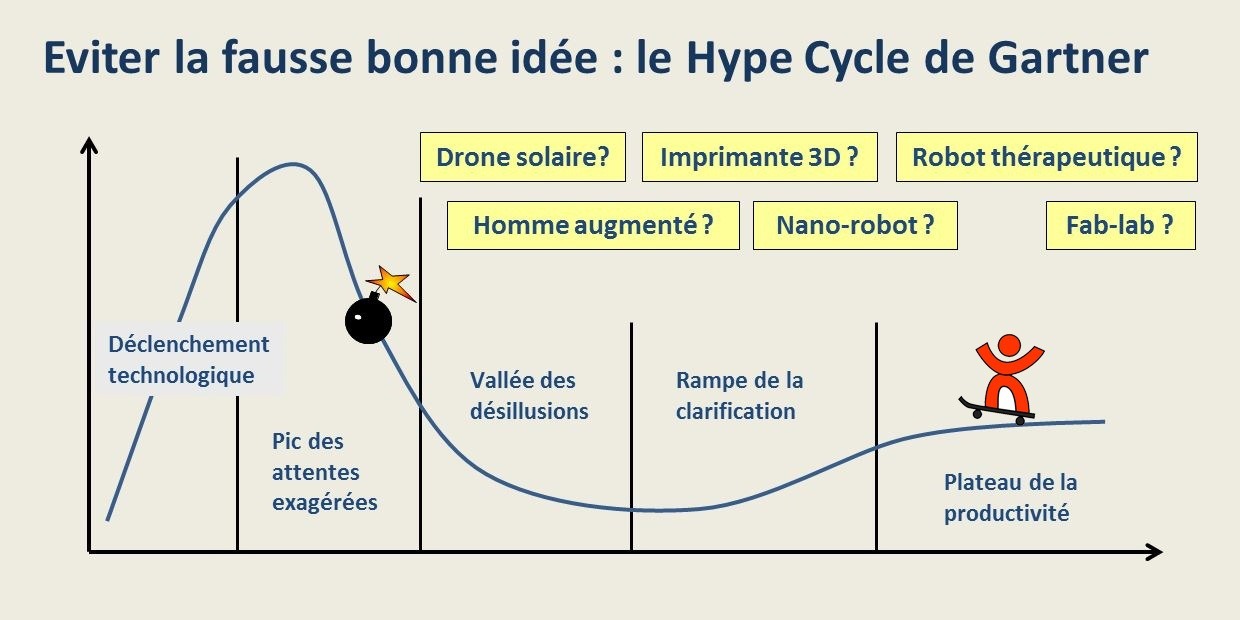 Allons un peu plus loin dans l’idée que les idées les plus populaires ne sont pas forcément les meilleures. Le cabinet américain Gartner publie chaque année une cartographie des innovations les plus populaires. D’année en année des innovations apparaissent, d’autres disparaissent. La courbe de Gartner illustre, de la gauche vers la droite le cycle de vie de nombreuses nouveautés. L’innovation entrante suscite l’enthousiasme des laboratoires, des industries de pointe et bien entendu des financeurs. Elle atteint très vite le « pic des attentes exagérées ». Puis elle chute dans la « vallée des désillusions ». Alors soit elle disparait purement et simplement, soit elle est mise en œuvre dans le seul domaine où elle a une utilité, ce qui est déjà pas mal. Ceci est de nature à nous inciter à prendre du recul et ne pas suivre de façon grégaire la dernière tendance à la mode.
Allons un peu plus loin dans l’idée que les idées les plus populaires ne sont pas forcément les meilleures. Le cabinet américain Gartner publie chaque année une cartographie des innovations les plus populaires. D’année en année des innovations apparaissent, d’autres disparaissent. La courbe de Gartner illustre, de la gauche vers la droite le cycle de vie de nombreuses nouveautés. L’innovation entrante suscite l’enthousiasme des laboratoires, des industries de pointe et bien entendu des financeurs. Elle atteint très vite le « pic des attentes exagérées ». Puis elle chute dans la « vallée des désillusions ». Alors soit elle disparait purement et simplement, soit elle est mise en œuvre dans le seul domaine où elle a une utilité, ce qui est déjà pas mal. Ceci est de nature à nous inciter à prendre du recul et ne pas suivre de façon grégaire la dernière tendance à la mode.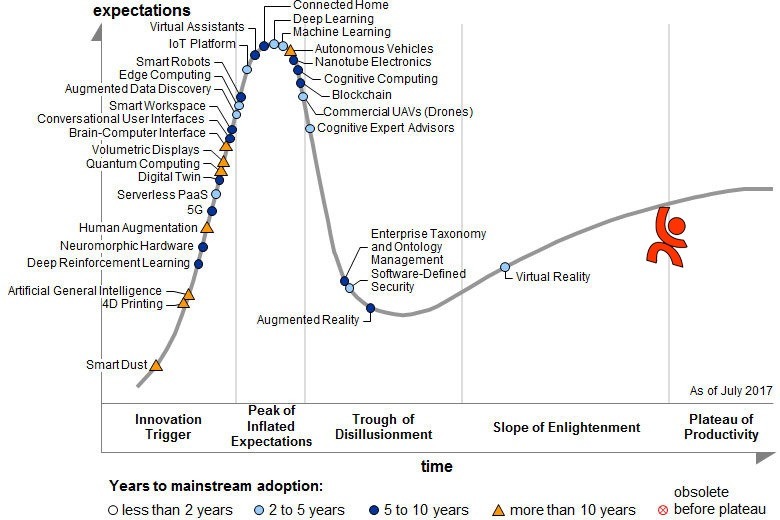 Voici la version 2017 du hype cycle de Gartner. Pour exemple, les drones commerciaux (Commercial UAVs) font moins rêver mais leur déploiement à grande échelle est prévue à échéance de 2 à 5 ans.
Voici la version 2017 du hype cycle de Gartner. Pour exemple, les drones commerciaux (Commercial UAVs) font moins rêver mais leur déploiement à grande échelle est prévue à échéance de 2 à 5 ans.Comment reconnaitre le « bon projet d’innovation »
 Voici les trois questions à se poser avant de se lancer dans un projet d’innovation. Ce petit schéma offre l’intérêt de mettre en avant les deux aspects souvent négligés par le créateur : A commencer par les désirs du client potentiel, c’est tout de même lui qui prendra la décision d’adopter ou pas l’innovation. Et le potentiel du marché. Si les clients potentiels ne sont pas à la fois nombreux, solvables et prêts à l’action, le projet n’a pas d’intérêt.
Voici les trois questions à se poser avant de se lancer dans un projet d’innovation. Ce petit schéma offre l’intérêt de mettre en avant les deux aspects souvent négligés par le créateur : A commencer par les désirs du client potentiel, c’est tout de même lui qui prendra la décision d’adopter ou pas l’innovation. Et le potentiel du marché. Si les clients potentiels ne sont pas à la fois nombreux, solvables et prêts à l’action, le projet n’a pas d’intérêt.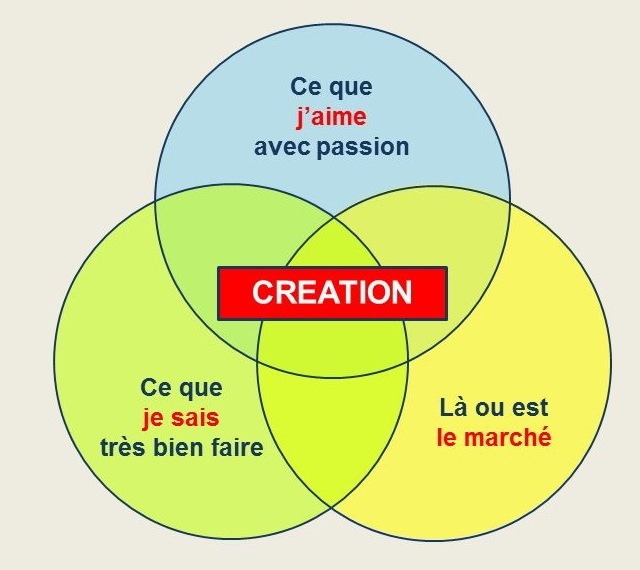 Voici une vision très proche du schéma précédent, orientée création d’entreprise. Si vous projetez de vous lancer dans cette magnifique aventure, vérifiez que votre idée satisfait aux trois aspects mis en avant sur ce schéma.
Voici une vision très proche du schéma précédent, orientée création d’entreprise. Si vous projetez de vous lancer dans cette magnifique aventure, vérifiez que votre idée satisfait aux trois aspects mis en avant sur ce schéma.De l’idée au projet d’innovation
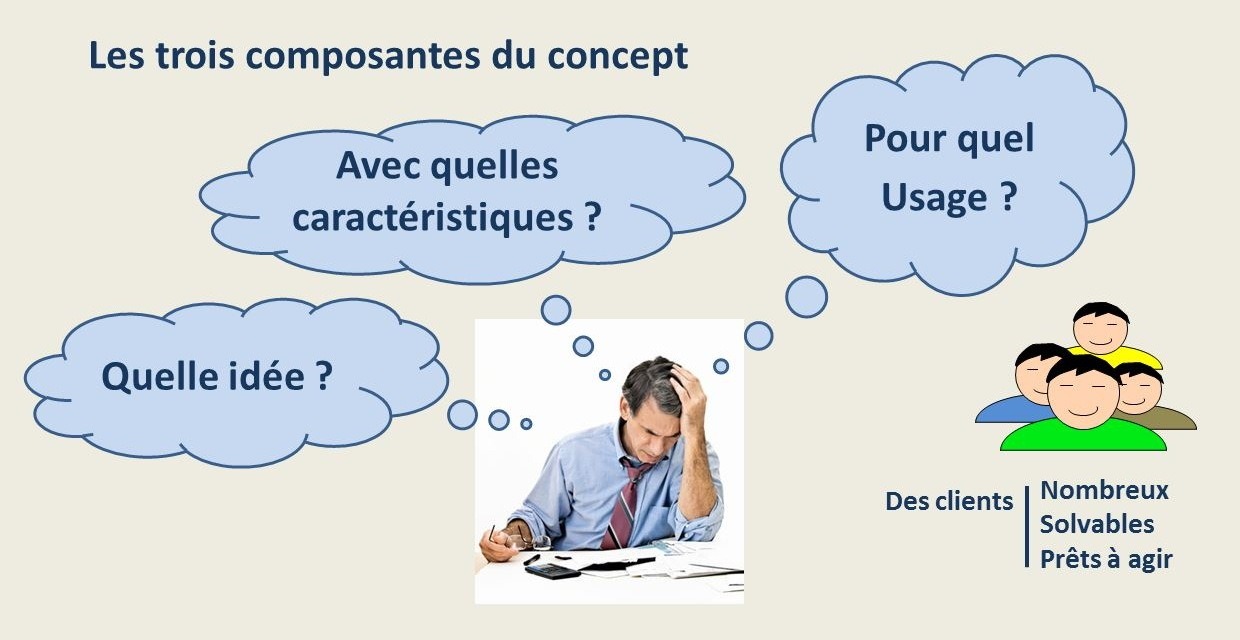 Entre l’idée de départ et le projet d’innovation il y a un état intermédiaire, c’est celui du concept. Pour le marketing, le concept est une représentation théorique de ce que pourrait être un nouveau produit ou service. Le concept c’est l’idée de départ plus les principales caractéristiques du système, plus l’usage auquel on destine ce système. Le concept s’exprime dans les termes qui appartiennent à l’univers du consommateur et non pas à celui du producteur. Il constitue la réponse aux trois questions : Qu’attend le consommateur ? Pourquoi achètera-t-il le produit/service ? Que fera-t-il du produit/service ?
Entre l’idée de départ et le projet d’innovation il y a un état intermédiaire, c’est celui du concept. Pour le marketing, le concept est une représentation théorique de ce que pourrait être un nouveau produit ou service. Le concept c’est l’idée de départ plus les principales caractéristiques du système, plus l’usage auquel on destine ce système. Le concept s’exprime dans les termes qui appartiennent à l’univers du consommateur et non pas à celui du producteur. Il constitue la réponse aux trois questions : Qu’attend le consommateur ? Pourquoi achètera-t-il le produit/service ? Que fera-t-il du produit/service ?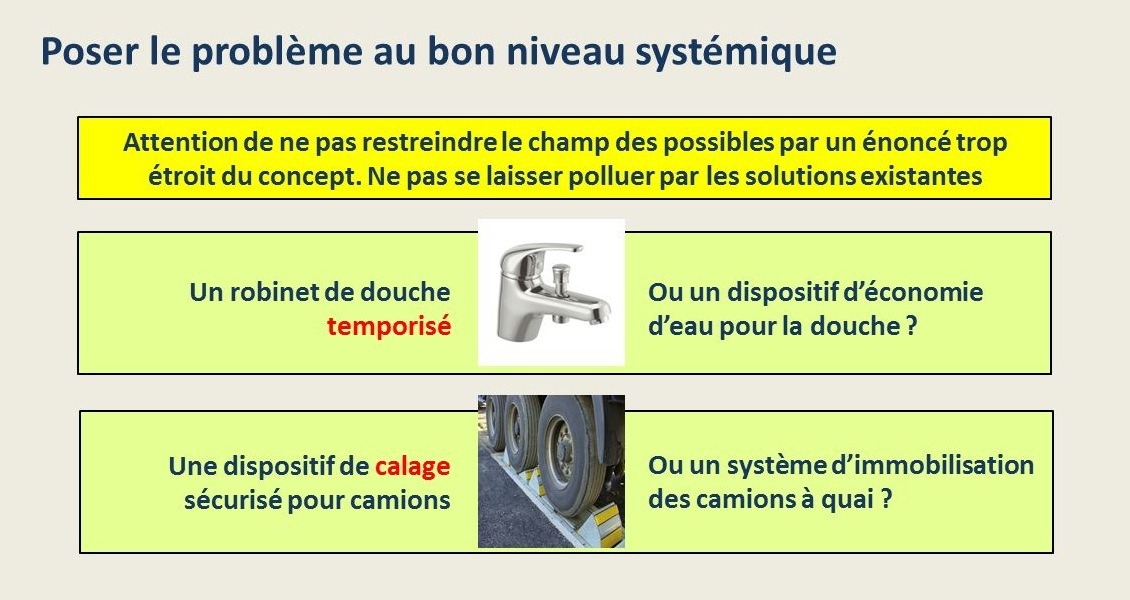 Lors de la formulation du concept, attention de bien poser le problème. Le danger est de poser le problème en orientant vers une solution, ce qui revient à éliminer de fait les autres solutions possibles dont peut-être celle qui aurait été à la fois plus simple, moins chère et plus satisfaisante pour l’utilisateur.
Lors de la formulation du concept, attention de bien poser le problème. Le danger est de poser le problème en orientant vers une solution, ce qui revient à éliminer de fait les autres solutions possibles dont peut-être celle qui aurait été à la fois plus simple, moins chère et plus satisfaisante pour l’utilisateur.Sélectionner les projet d’innovation avec la matrice d’attractivité
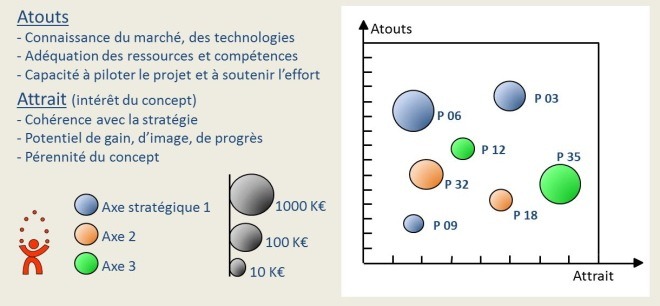 La meilleure chose que l’on peut vous souhaiter c’est d’avoir plus de projets d’innovation en portefeuille que vous ne pouvez en entreprendre. Se pose alors à vous le problème d’éliminer les moins intéressant et de sélectionner ceux auxquels vous allez consacrer vos ressources et votre énergie.
La meilleure chose que l’on peut vous souhaiter c’est d’avoir plus de projets d’innovation en portefeuille que vous ne pouvez en entreprendre. Se pose alors à vous le problème d’éliminer les moins intéressant et de sélectionner ceux auxquels vous allez consacrer vos ressources et votre énergie.L’outil adapté à ce travail de sélection est la matrice d’attractivité. Il s’agit d’un graphique sur lequel …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
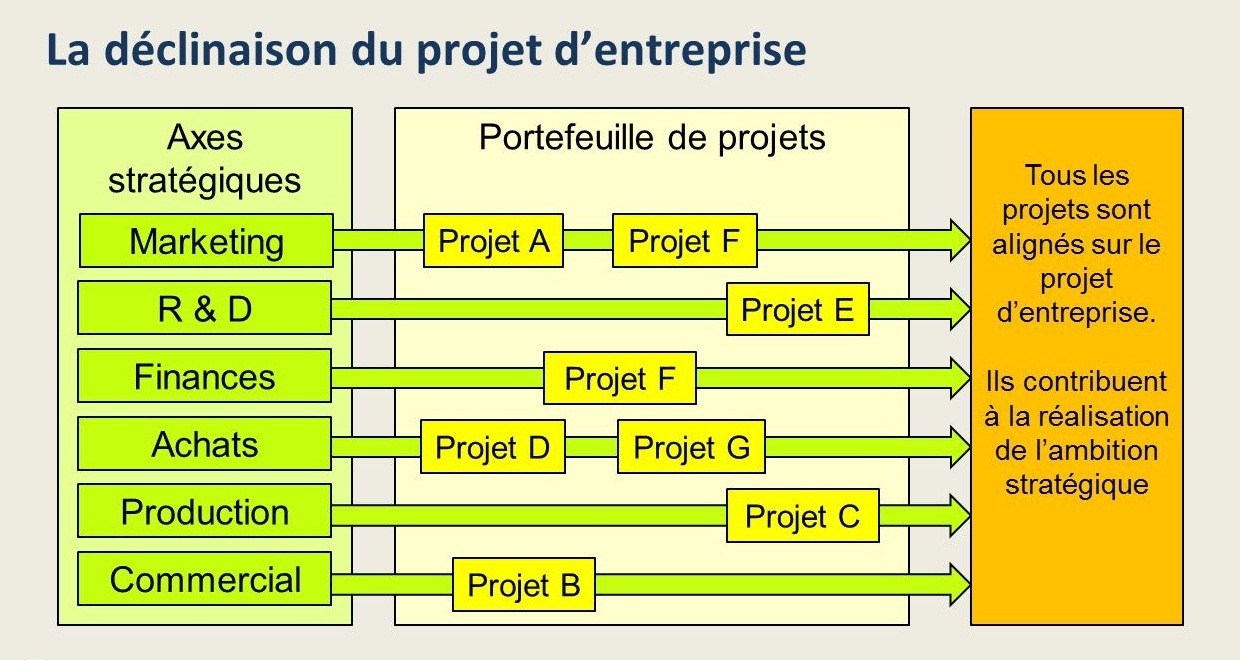 Rappelons au passage que dans un organisme correctement gérés, tous les projets, quel que soit le service qui les porte, doivent être alignés sur (au service de) l’ambition stratégique clairement définie par le dirigeant, comme symbolisé sur ce schéma.
Rappelons au passage que dans un organisme correctement gérés, tous les projets, quel que soit le service qui les porte, doivent être alignés sur (au service de) l’ambition stratégique clairement définie par le dirigeant, comme symbolisé sur ce schéma.Démontrer la rentabilité de l’investissement
Les questions d’investissement et de rentabilité sont traitées dans le chapitre « La gestion économique des projets » leçon « Projets d’investissement et rentabilité » Ne sont repris ici que les éléments directement utiles dans le cas du projet d’innovation. On se limitera notamment au calcul du délai de récupération du capital investi (DRCI), largement suffisante, compte tenu de l’incertitude sur les prévisions inhérente au domaine de l’innovation.Le principe est très simple : on cherche à savoir au bout de combien de temps les profits cumulés tirés de l’exploitation de l’innovation auront atteint le même montant que la somme dépensée pour introduire cette innovation.
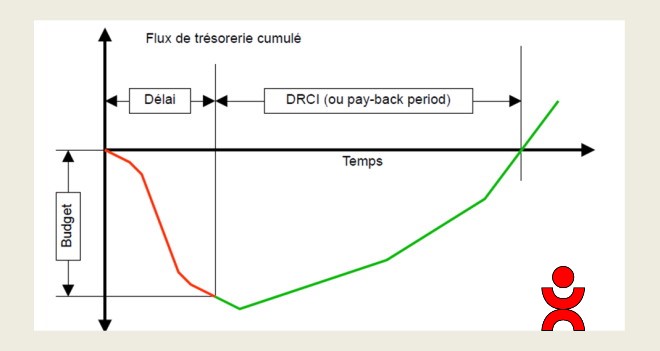 Nous allons en deux schémas décrire le principe et la méthode de calcul du DRCI. D’abord ce graphique : L’axe du temps figure en horizontal de gauche à droite. L’axe vertical est celui des flux de trésorerie cumulés (les entrées et les sorties d’argent). Le temps zéro correspond au …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
Nous allons en deux schémas décrire le principe et la méthode de calcul du DRCI. D’abord ce graphique : L’axe du temps figure en horizontal de gauche à droite. L’axe vertical est celui des flux de trésorerie cumulés (les entrées et les sorties d’argent). Le temps zéro correspond au …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
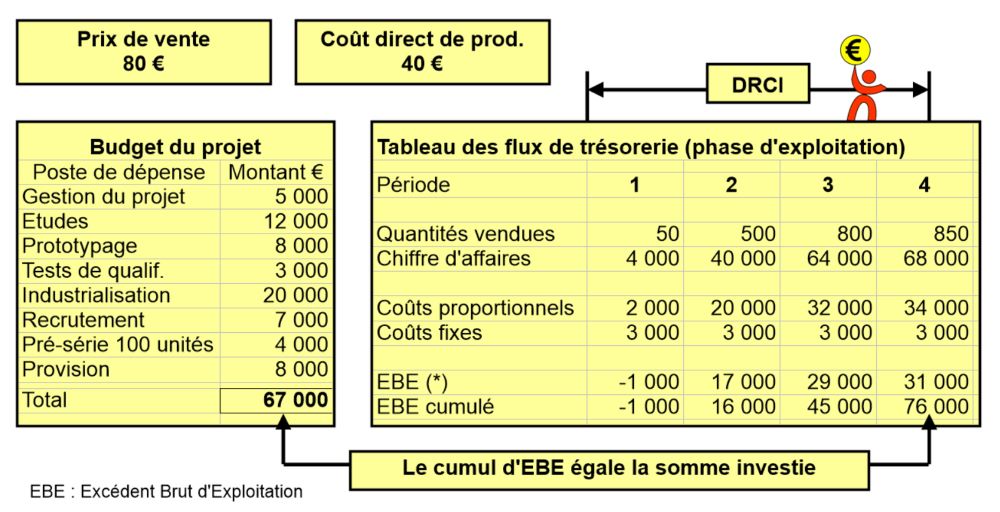 Les tableaux ci-contre illustrent la méthode de détermination du DRCI. Nous travaillons sur un produit industriel dont l’étude de marché a montré que l’on pouvait le vendre 80 €. Le bureau d’études a estimé son coût de production (fournitures et main d’œuvre) à 40 euro. Le budget (tableau de gauche) du projet d’innovation, provision comprise est de 67 000 €. Passons à la phase d’exploitation (tableau de droite). L’échelle de temps est divisée, dans l’exemple, en 4 périodes successives qui peuvent correspondre à des semestres. Les 4 colonnes (1 à 4) correspondent dans ce cas aux deux premières années d’exploitation.
Les tableaux ci-contre illustrent la méthode de détermination du DRCI. Nous travaillons sur un produit industriel dont l’étude de marché a montré que l’on pouvait le vendre 80 €. Le bureau d’études a estimé son coût de production (fournitures et main d’œuvre) à 40 euro. Le budget (tableau de gauche) du projet d’innovation, provision comprise est de 67 000 €. Passons à la phase d’exploitation (tableau de droite). L’échelle de temps est divisée, dans l’exemple, en 4 périodes successives qui peuvent correspondre à des semestres. Les 4 colonnes (1 à 4) correspondent dans ce cas aux deux premières années d’exploitation.La ligne « ventes » correspond au nombre d’unités vendues dans la période de temps. Les valeurs sont également issues de l’étude de marché.
La ligne « CA » correspond au chiffre d’affaires réalisé dans la période. Tout simplement le nombre d’unités vendues multiplié par le prix de vente unitaire (80 €)
La ligne « coûts variables » que l’on aurait également pu nommer « coût proportionnel » correspond aux coûts directs de production. Il s’obtient en multipliant le nombre d’unités vendues par le coût de revient unitaire (40 €)
La ligne « coûts fixes » correspond aux dépenses encourues par l’entreprise qu’il y ait des ventes ou qu’il n’y en ait pas. Loyers, chauffage, salaires indirects, abonnements divers…
La ligne « EBE » correspond à l’Excédent Brut d’Exploitation (le cash-flow) de la période. Le calcul est le suivant : EBE = CA – coûts.
La dernière ligne est celle de l’EBE cumulé.
Partant de là, le DRCI est atteint lorsque le cumul de l’EBE atteint le montant de l’investissement, ici 67000 €
- Le profil du chef de projet
- Constituer la bonne équipe de projet d’innovation
Le profil du chef de projet
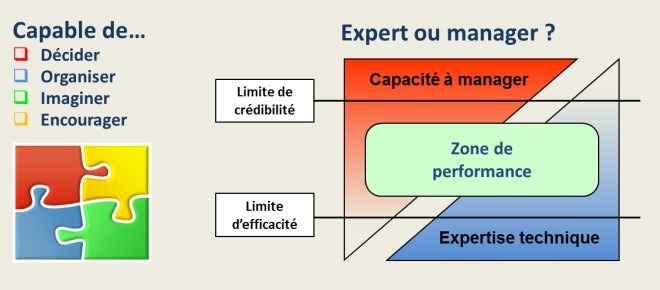 La question est souvent posée : Vaut-il mieux un chef de projet d’innovation expert technique ou un chef de projet manager ? La réponse est nette : ni l’un ni l’autre ! Le chef de projet expert risque de décider de tout, de dicter à ses équipiers tout ce qu’ils doivent faire, et au final de démotiver son équipe. Dans beaucoup de cas il finit par se retrouver surchargé du travail qu’il n’a pas délégué, entouré d’une équipe goguenarde qui n’attend qu’une chose : qu’il fasse une erreur. A l’inverse un chef de projet même excellent manager, s’il n’a pas un minimum de culture technique, perdra vite toute crédibilité tant vis à vis de son équipe qu’il est incapable d’aider que vis à vis du client dont il ne comprend pas les demandes. Les uns et les autres comprendront vite qu’il n’a pas de rôle utile et le marginaliseront, lui laissant juste un rôle honorifique. L’idéal est un chef de projet de grande culture technique, un minimum initié au métier, tout en étant un bon manager. En terme de compétences comportementales, il doit selon les situations être homme (ou femme) de décision, organisateur, créatif et soutien de l’équipe.
La question est souvent posée : Vaut-il mieux un chef de projet d’innovation expert technique ou un chef de projet manager ? La réponse est nette : ni l’un ni l’autre ! Le chef de projet expert risque de décider de tout, de dicter à ses équipiers tout ce qu’ils doivent faire, et au final de démotiver son équipe. Dans beaucoup de cas il finit par se retrouver surchargé du travail qu’il n’a pas délégué, entouré d’une équipe goguenarde qui n’attend qu’une chose : qu’il fasse une erreur. A l’inverse un chef de projet même excellent manager, s’il n’a pas un minimum de culture technique, perdra vite toute crédibilité tant vis à vis de son équipe qu’il est incapable d’aider que vis à vis du client dont il ne comprend pas les demandes. Les uns et les autres comprendront vite qu’il n’a pas de rôle utile et le marginaliseront, lui laissant juste un rôle honorifique. L’idéal est un chef de projet de grande culture technique, un minimum initié au métier, tout en étant un bon manager. En terme de compétences comportementales, il doit selon les situations être homme (ou femme) de décision, organisateur, créatif et soutien de l’équipe.Constituer la bonne équipe de projet d’innovation
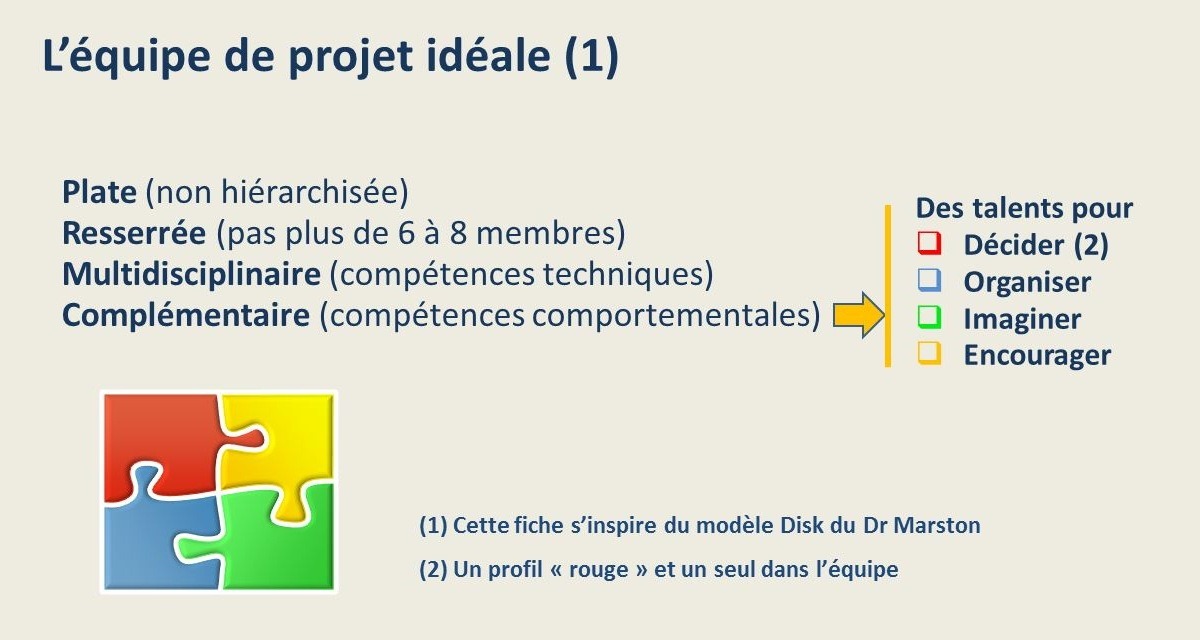 Bien entendu le chef de projet doit être entouré d’une équipe efficace. Il en est de la gestion de projet d’innovation comme du sport : l’équipe doit réunir de bonnes individualités mais cela ne suffit pas, le chef de projet devra créer la cohésion, susciter l’enthousiasme et insuffler un esprit d’équipe.
Bien entendu le chef de projet doit être entouré d’une équipe efficace. Il en est de la gestion de projet d’innovation comme du sport : l’équipe doit réunir de bonnes individualités mais cela ne suffit pas, le chef de projet devra créer la cohésion, susciter l’enthousiasme et insuffler un esprit d’équipe.- L’entreprise dans l’univers concurrentiel
- Stratégie d’excellence ou stratégie de différenciation ?
- Allons plus loin avec « Océan Bleu »
- Définir son offre de valeur avec le canevas stratégique
- Le business model d’Alexander Osterwalder
L’entreprise dans l’univers concurrentiel
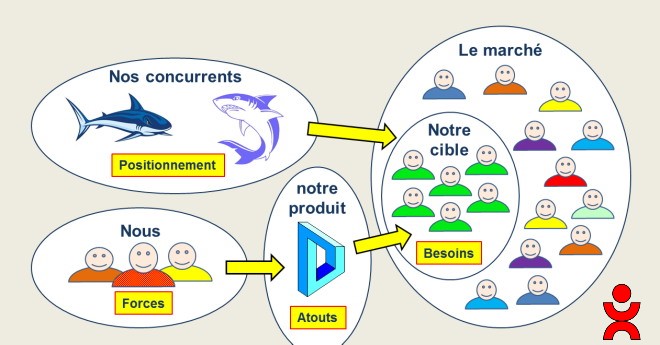 La première qualité d’une innovation est de trouver son public ! Autrement dit votre concept n’a d’intérêt que s’il est susceptible de déclencher l’acte d’achat chez un nombre suffisant d’acteurs économiques. Ceci suppose qu’il existe une population (votre cible) dont une partie au moins des attentes n’est pas satisfaite par l’offre existante, et que cette cible soit prête à adopter votre nouvelle offre et à en payer le prix. Telle est la problématique du positionnement marketing de votre produit.
La première qualité d’une innovation est de trouver son public ! Autrement dit votre concept n’a d’intérêt que s’il est susceptible de déclencher l’acte d’achat chez un nombre suffisant d’acteurs économiques. Ceci suppose qu’il existe une population (votre cible) dont une partie au moins des attentes n’est pas satisfaite par l’offre existante, et que cette cible soit prête à adopter votre nouvelle offre et à en payer le prix. Telle est la problématique du positionnement marketing de votre produit.Stratégie d’excellence ou stratégie de différenciation ?
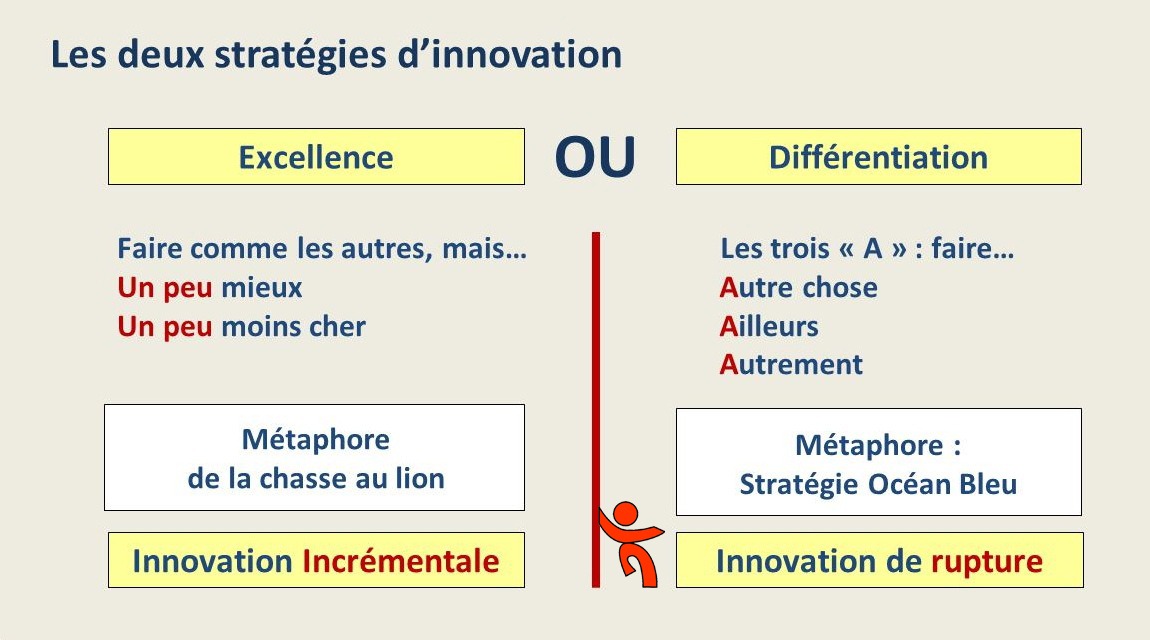 Avant d’aller plus loin posons-nous la question suivante : suffit-il de faire comme ses concurrents mais un peu mieux (ou un peu moins cher) que ses concurrents pour conquérir des parts de marché ? Si vous pensez que oui vous êtes dans une logique d’excellence. Cette attitude vous honore, mais on peut vous objecter trois points : d’abord ne vous attendez pas à un succès foudroyant, si progression il y a elle sera forcément lente. Ensuite si vous comptez sur une baisse du prix pour capter des clients, la seule certitude est que vous allez baisser votre marge et peu-être entrainer vos concurrents dans une spirale destructrice. Enfin la simple observation montre que les entreprises gagnantes sont ceux qui jouent la différenciation plutôt que l’excellence. Voyez Apple, Ikea, Xerox, Ryanair, ces entreprises et bien d’autres ont su créer un concept singulier et capter une clientèle qui ne trouvait pas son bonheur dans l’offre classique.
Avant d’aller plus loin posons-nous la question suivante : suffit-il de faire comme ses concurrents mais un peu mieux (ou un peu moins cher) que ses concurrents pour conquérir des parts de marché ? Si vous pensez que oui vous êtes dans une logique d’excellence. Cette attitude vous honore, mais on peut vous objecter trois points : d’abord ne vous attendez pas à un succès foudroyant, si progression il y a elle sera forcément lente. Ensuite si vous comptez sur une baisse du prix pour capter des clients, la seule certitude est que vous allez baisser votre marge et peu-être entrainer vos concurrents dans une spirale destructrice. Enfin la simple observation montre que les entreprises gagnantes sont ceux qui jouent la différenciation plutôt que l’excellence. Voyez Apple, Ikea, Xerox, Ryanair, ces entreprises et bien d’autres ont su créer un concept singulier et capter une clientèle qui ne trouvait pas son bonheur dans l’offre classique.Vous avez compris que le conseil donné ici est d’opter franchement pour une stratégie de différentiation. Votre produit sera conçu dans l’idée d’apporter une réponse décalée de celle de vos concurrents. Les clients viendront chez vous car ils ne trouvent pas dans l’offre existante ce que vous leur offrez en terme d’usage, de service, de plaisir… ou de prix.
Allons plus loin avec Océan Bleu
 Le livre « Stratégie Océan Bleu » s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires dans le monde. La thèse défendue par ses auteurs est la suivante : L’entreprise qui se trouve dans un environnement concurrentiel saturé, où les produits se ressemblent de plus en plus et où la guerre des prix fait rage, doit s’affranchir des contraintes de son marché.
Le livre « Stratégie Océan Bleu » s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires dans le monde. La thèse défendue par ses auteurs est la suivante : L’entreprise qui se trouve dans un environnement concurrentiel saturé, où les produits se ressemblent de plus en plus et où la guerre des prix fait rage, doit s’affranchir des contraintes de son marché.Océan rouge, océan bleu
Le rouge est la couleur du sang. Métaphoriquement, l’océan rouge est celui dans lequel l’entreprise livre bataille contre ses concurrents. A l’opposé, l’océan bleu c’est la masse des clients/utilisateur insatisfaits de l’offre existante ou prêts à se laisser séduire par un produit/service différent.
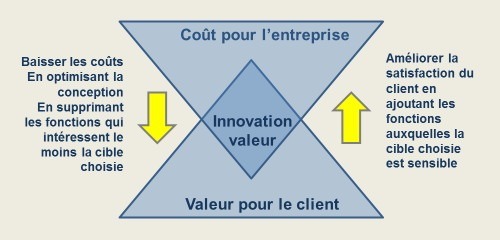 Ce que les auteurs du livre « Stratégie Océan Bleu » nomment le concept d’innovation-valeur est un principe connu depuis les années 1960 et mis en pratique notamment dans la démarche d’analyse de la valeur. Tout au plus le schéma qui illustre le concept est-il original (reproduit ci-contre). Le succès du produit/service est représenté par la zone centrale verte correspondant à la superposition des deux triangles. Pour augmenter la surface verte (la profitabilité du produit), deux moyens : réduire les coûts ou augmenter la valeur perçue par le client.
Ce que les auteurs du livre « Stratégie Océan Bleu » nomment le concept d’innovation-valeur est un principe connu depuis les années 1960 et mis en pratique notamment dans la démarche d’analyse de la valeur. Tout au plus le schéma qui illustre le concept est-il original (reproduit ci-contre). Le succès du produit/service est représenté par la zone centrale verte correspondant à la superposition des deux triangles. Pour augmenter la surface verte (la profitabilité du produit), deux moyens : réduire les coûts ou augmenter la valeur perçue par le client.Tourner le dos à la concurrence
Pour tourner le dos à la concurrence il faut proposer un produit différent. Contrairement à une idée très répandue un produit n’a pas besoin d’être excellent dans tous les registres. L’une des idées vraiment novatrices des auteurs est de choisir délibérément les caractéristiques qui seront absentes du produit ou largement inférieures à la concurrence.
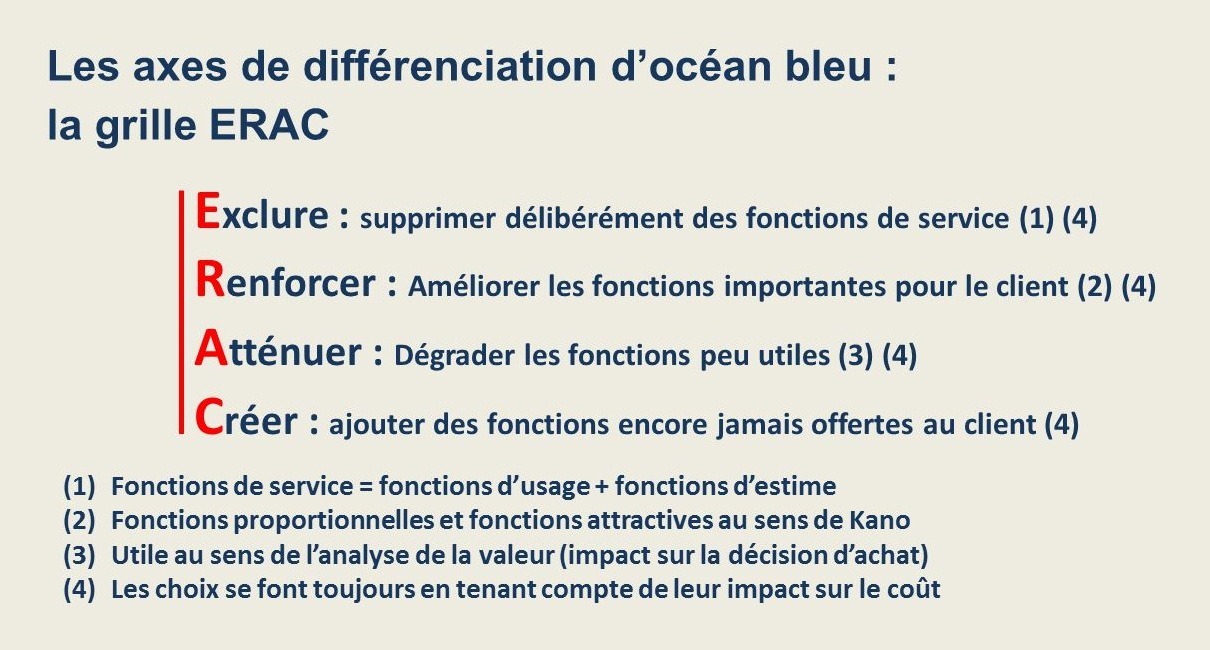 Autre outil de la stratégie Océan Bleu, la grille ERAC qui permet d’identifier des axes de différentiation.
Autre outil de la stratégie Océan Bleu, la grille ERAC qui permet d’identifier des axes de différentiation.Définir son offre de valeur avec le canevas stratégique
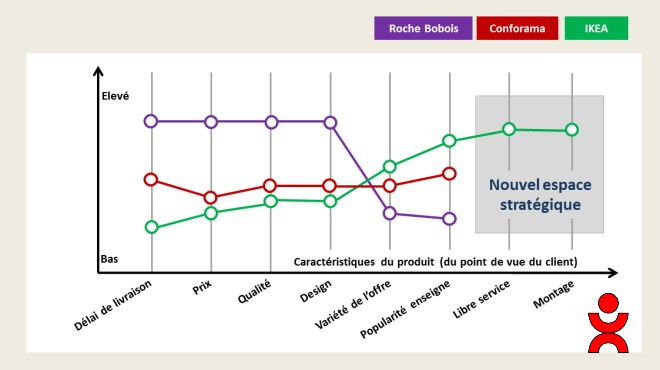 L’outil central de la stratégie océan bleu est le canevas stratégique. Il s’agit d’une représentation de la performance comparée des produits en compétition. Cet exemple fictif compare l’offre IKEA à deux de ses concurrents : Conforama et Roche Bobois. On voit comment IKEA prend le contrepied total de l’offre Roche Bobois et de différencie de Conformama en introduisant deux caractéristiques exclusives : le kit à monter à la maison et les magasins en libre service. Lorsque vous utiliserez le canevas stratégique ne recherchez pas la précision, vous avez remarqué que l’échelle verticale ne comporte que deux valeurs : « Bas » et « Élevé ».
L’outil central de la stratégie océan bleu est le canevas stratégique. Il s’agit d’une représentation de la performance comparée des produits en compétition. Cet exemple fictif compare l’offre IKEA à deux de ses concurrents : Conforama et Roche Bobois. On voit comment IKEA prend le contrepied total de l’offre Roche Bobois et de différencie de Conformama en introduisant deux caractéristiques exclusives : le kit à monter à la maison et les magasins en libre service. Lorsque vous utiliserez le canevas stratégique ne recherchez pas la précision, vous avez remarqué que l’échelle verticale ne comporte que deux valeurs : « Bas » et « Élevé ».Le business model d’Alexander Osterwalder
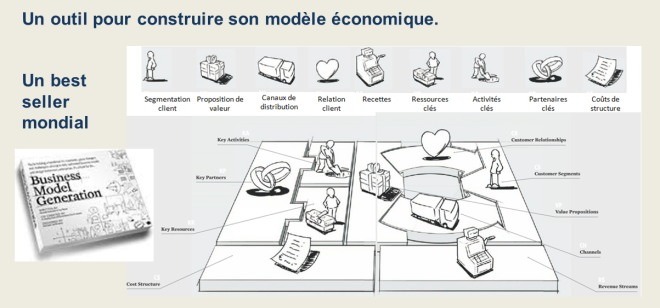 L’expression « Business model » se traduit en français par « Modèle d’affaires » ou par « Modèle d’entreprise ». Le modèle d’affaires décrit la façon dont une organisation (le plus souvent une entreprise) gagne de l’argent. Ou plutôt espère en gagner car cet outil est utilisé dans les situations de création d’entreprise ou de projet d’innovation.
L’expression « Business model » se traduit en français par « Modèle d’affaires » ou par « Modèle d’entreprise ». Le modèle d’affaires décrit la façon dont une organisation (le plus souvent une entreprise) gagne de l’argent. Ou plutôt espère en gagner car cet outil est utilisé dans les situations de création d’entreprise ou de projet d’innovation.Le livre « Business Model Nouvelle Génération » d’Alexander Osterwalder et Yves Pigneur, paru en 2010 aux USA et dès 2011 en France a été un succès mondial. La méthode décrite dans l’ouvrage est utilisée dans de nombreuses entreprises pour leur projet d’innovation et par de nombreux consultants en innovation. Le « modèle » propose comme support de travail un unique schéma désormais célèbre, le Business model canvas (*), représenté ci-contre dans sa version originelle et ci-dessous sous une forme plus facilement utilisable.
(*) De nombreuses personnes emploient l’expression « méthode canvas » pour désigner la méthode décrite par Osterwalder. C’est une mauvaise traduction de l’américain, le mot canvas ne désigne pas la méthode elle-même mais le schéma qui lui sert de support (canvas = trame)
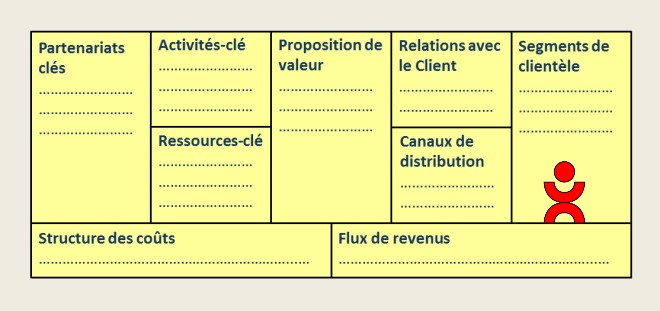 Le canevas est formé de 9 blocs correspondant chacun à l’un des domaines du projet d’innovation à explorer. Les 9 domaines sont organisés en forme de flux de la gauche vers la droite. La réflexion se fait en groupe de travail idéalement réuni devant un grand tableau représentant le canevas. Au fil de la réunion, les participants utilisent des post-it et des markers de couleur pour visualiser le résultat de leur réflexion. Voici un résumé du contenu des 9 blocs :
Le canevas est formé de 9 blocs correspondant chacun à l’un des domaines du projet d’innovation à explorer. Les 9 domaines sont organisés en forme de flux de la gauche vers la droite. La réflexion se fait en groupe de travail idéalement réuni devant un grand tableau représentant le canevas. Au fil de la réunion, les participants utilisent des post-it et des markers de couleur pour visualiser le résultat de leur réflexion. Voici un résumé du contenu des 9 blocs :Segments de clientèle : Une offre n’est jamais universelle, elle vise forcément une portion bien identifiée du marché global, qui devient ainsi votre cible. Quelle est cette cible, quelles sont ses …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
- L’entreprise, créatrice de valeur… pour qui ?
- Les deux faces de l’analyse fonctionnelle
- L’analyse fonctionnelle externe
- De la pyramide de Maslow aux fonctions du produit
- Fonctions d’usage, fonctions d’estime et contraintes
- Le diagramme de Kano
- Le rôle du design : désirabilité, acceptabilité et utilisabilité du produit
- La démarche d’analyse fonctionnelle
- Du cycle de vie aux cas d’utilisation
- La rosace d’interactions
- Idéalité et « récits utilisateurs »
- L’arbre fonctionnel
- Le Cahier des Charges Fonctionnel (CDCF) référentiel du besoin
L’entreprise, créatrice de valeur… pour qui ?
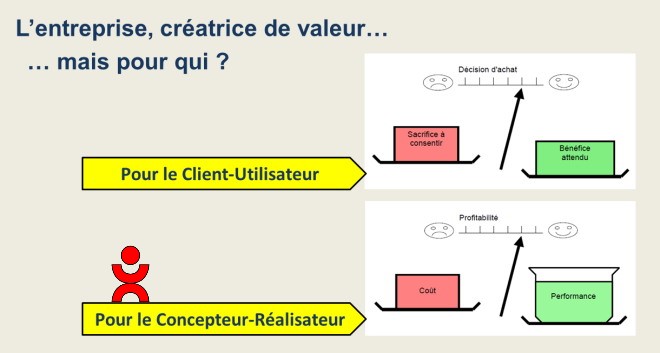 Commençons par préciser les notions de prix, de coût et surtout de valeur.
Commençons par préciser les notions de prix, de coût et surtout de valeur.Le prix, c’est la somme d’argent que va devoir débourser le Client pour acquérir le produit. On parle quelquefois de « valeur d’échange ».
Le coût, c’est le total des dépenses engagées par l’entreprise pour réaliser le produit et le mettre à disposition du Client. L’expression « prix de revient » est souvent utilisée.
La Valeur est une notion abstraite qui correspond à l’intérêt qu’une personne porte à un bien ou a un service.
La valeur pour le Client-utilisateur
Pour le Client, la valeur du produit qu’il convoite augmente dans deux cas : soit si les sacrifices qu’il consent pour l’acquérir (dont le prix) et le mettre en service diminuent, soit si le bénéfice qu’il en attend se trouve augmenté. Le schéma ci-contre figure la « balance du désir »
La valeur pour le Concepteur-réalisateur
Pour le concepteur, la valeur du produit augmente lorsque son coût diminue ou lorsque sa performance augmente. Dans les deux cas son profit va croitre. Si la performance augmente les Clients seront plus nombreux à acheter. Si le coût diminue, soit le prix baisse et les quantités vendues augmentent, soit le prix reste inchangé et la marge par produit augmente. Notons qu’il ne sert à rien de faire croitre la performance au-delà de ce que le Client estime parfait (sur le schéma, le récipient déborde)
 Voyons d’un peu plus près ce qui conditionne la profitabilité du produit, et concentrons-nous sur le plateau de gauche de la balance, qui représente les sources de coût. Les entreprises sont rompues à la chasse aux coûts : Les service achats, méthode, maintenance et qualité agissent classiquement et souvent avec efficacité sur la partie représentée en blanc sur le schéma : gaspillages, déchets, rebuts de fabrication, dysfonctionnements et autres opérations sans valeur ajoutée. Ce que beaucoup de dirigeants ignorent la plupart du temps c’est le gain souvent considérable qu’ils obtiendraient (souvent plus de 30%) en remettant en cause la conception même du produit. J’invite ceux qui souhaiteraient s’engager dans une telle démarche à lire attentivement la leçon suivante (sur les outils de l’innovation technologique) et à ne pas hésiter à se lancer dans une analyse de la valeur.
Voyons d’un peu plus près ce qui conditionne la profitabilité du produit, et concentrons-nous sur le plateau de gauche de la balance, qui représente les sources de coût. Les entreprises sont rompues à la chasse aux coûts : Les service achats, méthode, maintenance et qualité agissent classiquement et souvent avec efficacité sur la partie représentée en blanc sur le schéma : gaspillages, déchets, rebuts de fabrication, dysfonctionnements et autres opérations sans valeur ajoutée. Ce que beaucoup de dirigeants ignorent la plupart du temps c’est le gain souvent considérable qu’ils obtiendraient (souvent plus de 30%) en remettant en cause la conception même du produit. J’invite ceux qui souhaiteraient s’engager dans une telle démarche à lire attentivement la leçon suivante (sur les outils de l’innovation technologique) et à ne pas hésiter à se lancer dans une analyse de la valeur.Les deux faces de l’analyse fonctionnelle
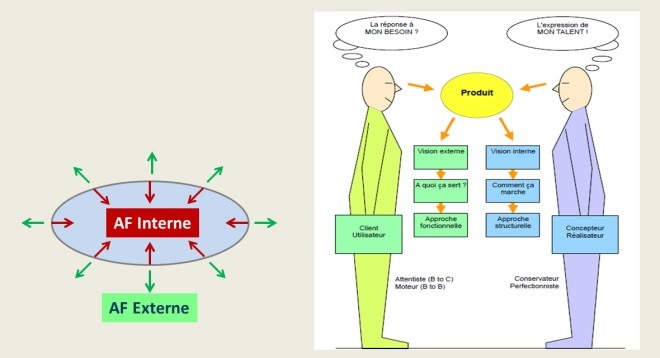 Le terme d’analyse fonctionnelle, utilisé seul, est ambigu. Il y a deux formes d’analyse fonctionnelle diamétralement opposées, bien que complémentaires : l’analyse du besoin et l’analyse de la structure du produit (ou des différents produits) répondant à ce besoin.
Le terme d’analyse fonctionnelle, utilisé seul, est ambigu. Il y a deux formes d’analyse fonctionnelle diamétralement opposées, bien que complémentaires : l’analyse du besoin et l’analyse de la structure du produit (ou des différents produits) répondant à ce besoin.L’analyse fonctionnelle externe
Le recueil des exigences, ou analyse du besoin ou encore analyse fonctionnelle externe consiste à établir la liste des fonctions offertes par un produit (ou un service) pour satisfaire le besoin de son utilisateur. Cette démarche est mise en œuvre en tout début de projet, lorsqu’il s’agit de fixer le cadre de travail et plus précisément …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
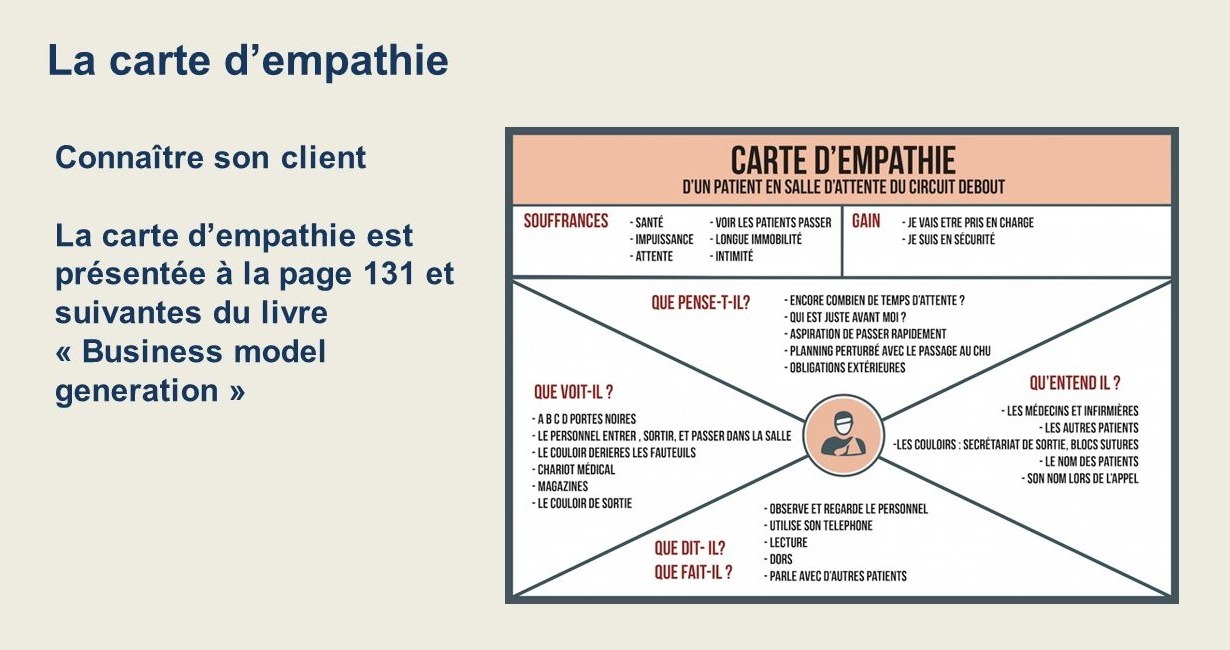 On ne dira jamais assez l’importance dans le projet d’innovation d’une prise en compte très fine des différentes parties prenantes, au premier rang desquelles le client (celui qui paie) l’utilisateur final et, s’il en existe, les prescripteurs. Voici un outil d’investigation, la carte d’empathie, qui permet d’énoncer avec une grande finesse les attentes d’une personne dans une situation bien précise (ici un malade dans la salle d’attente d’un hôpital.
On ne dira jamais assez l’importance dans le projet d’innovation d’une prise en compte très fine des différentes parties prenantes, au premier rang desquelles le client (celui qui paie) l’utilisateur final et, s’il en existe, les prescripteurs. Voici un outil d’investigation, la carte d’empathie, qui permet d’énoncer avec une grande finesse les attentes d’une personne dans une situation bien précise (ici un malade dans la salle d’attente d’un hôpital.De la pyramide de Maslow aux fonctions du produit
 Abraham Maslow (1916-1972) est connu pour avoir représenté les besoins de l’individu sous la forme de la pyramide représentée ci-contre. Le principe est que l’individu cherche prioritairement à satisfaire ses besoins physiologiques (manger, s’abriter des intempéries). Ceci étant acquis il s’attache à assurer sa sécurité et celle des siens. Une fois ces besoins primaires satisfaits il se découvre des besoins d’une nature plus abstraite : appartenir à un groupe, être reconnu par ses pairs et enfin avoir le sentiment de réussir sa vie. La pyramide de Maslow est très utilisée par les formateurs en sciences humaines. Elle est également pertinente en matière d’innovation dans la mesure ou elle met en lumière l’existence de deux catégories de besoins : objectifs (une voiture sert à se déplacer, une vanne à maîtriser le débit d’un fluide…) et les besoins subjectifs (une voiture sert aussi à afficher l’appartenance de son propriétaire à un groupe social, l’aspect extérieur d’une vanne doit être en harmonie avec les matériels environnants, être vecteur de l’image voulue par son fabricant….)
Abraham Maslow (1916-1972) est connu pour avoir représenté les besoins de l’individu sous la forme de la pyramide représentée ci-contre. Le principe est que l’individu cherche prioritairement à satisfaire ses besoins physiologiques (manger, s’abriter des intempéries). Ceci étant acquis il s’attache à assurer sa sécurité et celle des siens. Une fois ces besoins primaires satisfaits il se découvre des besoins d’une nature plus abstraite : appartenir à un groupe, être reconnu par ses pairs et enfin avoir le sentiment de réussir sa vie. La pyramide de Maslow est très utilisée par les formateurs en sciences humaines. Elle est également pertinente en matière d’innovation dans la mesure ou elle met en lumière l’existence de deux catégories de besoins : objectifs (une voiture sert à se déplacer, une vanne à maîtriser le débit d’un fluide…) et les besoins subjectifs (une voiture sert aussi à afficher l’appartenance de son propriétaire à un groupe social, l’aspect extérieur d’une vanne doit être en harmonie avec les matériels environnants, être vecteur de l’image voulue par son fabricant….)La plupart des ingénieurs et techniciens chargés de concevoir les produits industriels sous-estiment très largement le poids des besoins subjectif dans la décision d’achat. Il en résulte des produits efficaces en terme d’usage mais qui ne provoquent pas le désir et de ce fait se vendent mal. La plupart du temps le client détermine son choix de façon plus ou moins consciente pour satisfaire ses besoins subjectifs, et justifie ensuite son choix sur des critères objectifs.
Fonctions d’usage, fonctions d’estime et contraintes
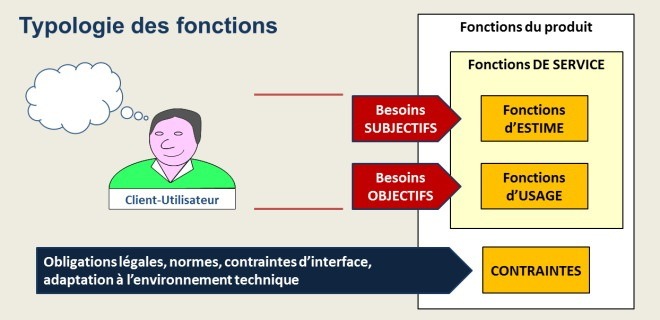 Le produit industriel n’est rien d’autre que la réponse apportée aux besoins du client-utilisateur. A chaque composante du besoin correspond une fonction du produit. On appelle fonction une action du produit en réponse au besoin de l’utilisateur. A titre d’exemples, une montre doit indiquer le jour et l’heure, résister aux chocs, résister à l’immersion, valoriser son propriétaire, etc. Les expressions « indiquer le jour et l’heure », « résister aux chocs », « résister à l’immersion », « valoriser son propriétaire » sont des fonctions de la montre. Un totale cohérence avec ce qui précède, on distingue les fonctions d’usage qui apportent une réponse aux besoins objectifs et les fonctions d’estime qui apportent une réponse aux besoins subjectifs. Il est d’usage de rajouter à ces deux types de fonction une troisième catégorie que sont les…….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
Le produit industriel n’est rien d’autre que la réponse apportée aux besoins du client-utilisateur. A chaque composante du besoin correspond une fonction du produit. On appelle fonction une action du produit en réponse au besoin de l’utilisateur. A titre d’exemples, une montre doit indiquer le jour et l’heure, résister aux chocs, résister à l’immersion, valoriser son propriétaire, etc. Les expressions « indiquer le jour et l’heure », « résister aux chocs », « résister à l’immersion », « valoriser son propriétaire » sont des fonctions de la montre. Un totale cohérence avec ce qui précède, on distingue les fonctions d’usage qui apportent une réponse aux besoins objectifs et les fonctions d’estime qui apportent une réponse aux besoins subjectifs. Il est d’usage de rajouter à ces deux types de fonction une troisième catégorie que sont les…….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
Le diagramme de Kano
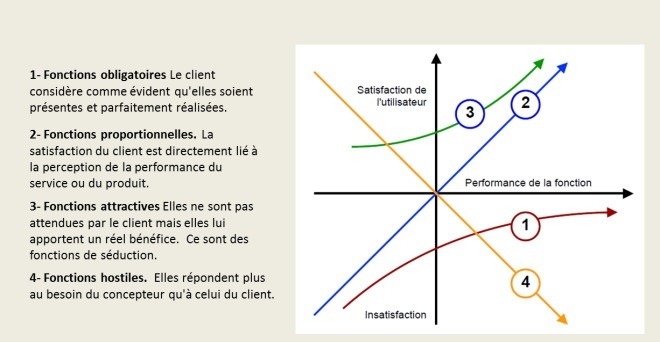 Jusqu’à ce qu’en 1984 le japonais Noriaki Kano bouscule cette vision, il était admis que le satisfaction du client vis à vis d’une fonction du produit était proportionnelle à la performance de réalisation de cette fonction. Le diagramme de Kano est reproduit ci-contre. Il consiste en un jeu de courbes sur un système d’axes orthogonal. L’axe vertical figure la satisfaction ou l’insatisfaction de l’utilisateur, le point neutre (indifférence) est au point d’intersection des axes. L’axe horizontal figure le degré de réalisation de la fonction. A gauche fonction non présente ou très mal satisfaite. A droite fonction parfaitement réalisée.
Jusqu’à ce qu’en 1984 le japonais Noriaki Kano bouscule cette vision, il était admis que le satisfaction du client vis à vis d’une fonction du produit était proportionnelle à la performance de réalisation de cette fonction. Le diagramme de Kano est reproduit ci-contre. Il consiste en un jeu de courbes sur un système d’axes orthogonal. L’axe vertical figure la satisfaction ou l’insatisfaction de l’utilisateur, le point neutre (indifférence) est au point d’intersection des axes. L’axe horizontal figure le degré de réalisation de la fonction. A gauche fonction non présente ou très mal satisfaite. A droite fonction parfaitement réalisée.Noriaki Kano a identifié 4 type de fonctions :
1- Fonctions obligatoires
Les fonctions obligatoires correspondent aux besoins implicites. Elles n’apportent aucune satisfaction au client, qui considère comme évident qu’elles soient présentes et parfaitement réalisées.
Exemples : la présence de freins sur une voiture. L’exactitude des calculs d’un logiciel. La disponibilité du dépanneur. Le temps d’accès à un site web. Le café chaud au bar.
2- Fonctions proportionnelles
Elles correspondent aux besoins exprimés. La satisfaction est directement lié à…….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
Le rôle du design : désirabilité, acceptabilité et utilisabilité du produit
 Nous avons parlé plus haut de fonctions d’estime, et nous avons insisté sur leur importance dans le déclenchement de l’acte d’achat. C’est la mission essentielle du designer que de travailler sur les fonctions d’estime. De la même façon que l’on sous-estime souvent l’importance des fonctions d’estime, on réduit le rôle du désigner à intervenir à la fin du processus de conception pour « humaniser » un peu le produit par quelques artifices cosmétiques. Erreur totale ! Le désigner doit être impliqué dès le début du projet d’innovation. Il est essentiel qu’il ait une parfaite connaissance de la « cible » marketing, de ses codes et de ses usages. Il doit également avoir connaissance du positionnement marketing du produit, du message et des valeurs dont le produit sera le vecteur. Le designer doit être impliqué dans la conception même du produit. Il a son mot à dire dans les choix architecturaux. C’est souvent la personne la mieux à même de représenter l’utilisateur et de pousser l’équipe de conception à prendre en compte les critères d’ergonomie et d’utilisabilité. C’est lui qui rend le produit non seulement acceptable mais désirable. Concluons ce thème par cette citation du docteur Claude Olivenstein : « comprendre, au-delà de la demande, le désir ». C’est ce que fait le designer et c’est en cela que son rôle est déterminant.
Nous avons parlé plus haut de fonctions d’estime, et nous avons insisté sur leur importance dans le déclenchement de l’acte d’achat. C’est la mission essentielle du designer que de travailler sur les fonctions d’estime. De la même façon que l’on sous-estime souvent l’importance des fonctions d’estime, on réduit le rôle du désigner à intervenir à la fin du processus de conception pour « humaniser » un peu le produit par quelques artifices cosmétiques. Erreur totale ! Le désigner doit être impliqué dès le début du projet d’innovation. Il est essentiel qu’il ait une parfaite connaissance de la « cible » marketing, de ses codes et de ses usages. Il doit également avoir connaissance du positionnement marketing du produit, du message et des valeurs dont le produit sera le vecteur. Le designer doit être impliqué dans la conception même du produit. Il a son mot à dire dans les choix architecturaux. C’est souvent la personne la mieux à même de représenter l’utilisateur et de pousser l’équipe de conception à prendre en compte les critères d’ergonomie et d’utilisabilité. C’est lui qui rend le produit non seulement acceptable mais désirable. Concluons ce thème par cette citation du docteur Claude Olivenstein : « comprendre, au-delà de la demande, le désir ». C’est ce que fait le designer et c’est en cela que son rôle est déterminant.Encore quelques mots sur le design
Les ingénieurs débutants sont quasiment tous convaincus que le designer agit seulement sur l’apparence visuelle du produit. La réalité est bien différente : Le desing du produit agit bien entendu sur l’individu par le canal visuel, mais aussi par l’audition et le toucher, quelquefois par l’odorat. La sonorité d’un moteur de voiture, le « clic » d’un interrupteur électrique, le toucher d’une coucerture de livre, la fluidité du mouvement d’une touche de clavier d’ordinateur ou des bagues d’un objectif photographique sont étudiés avec un grand soin.
Notre cerveau se fait une idée de la qualité d’un produit à partir ce ces indices beaucoup plus que par les arguments objectifs, et notre décision d’achat est plus souvent prise en fonction du désir ressenti que des critères objectifs. Ceci est vrai y compris pour les achats réalisés dans le cadre professionnel : le tableau comparatif présenté à la hiérarchie est souvent orienté pour favoriser le choix de l’inconscient.
Voici quelques notions complémentaires :
Utilisabilité du produit
L’utilisabilité est définie par la norme ISO 9241, comme « le degré selon lequel un produit peut être utilisé, par des utilisateurs identifiés, pour atteindre des buts définis, dans un contexte d’utilisation spécifié ».
Les critères de jugement de l’utilisabilité sont :
– l’efficacité : permettre à l’utilisateur d’atteindre l’objectif qu’il s’est fixé
– L’efficience : permettre à l’utilisateur d’atteindre avec un minimum d’efforts l’objectif qu’il s’est fixé
– La satisfaction exprimée par l’utilisateur
Ergonomie
L’ergonomie est « l’étude scientifique de la relation entre l’Homme et ses moyens, méthodes et milieux de travail » et l’application de ces connaissances à la conception de systèmes « qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et d’efficacité par le plus grand nombre »
L’ergonomie des interfaces logicielles est une composante que beaucoup de développeurs ont tendance à ignorer. Il en résulte des logiciels difficiles à appréhender et dont la logique de fonctionnement échappe aux utilisateurs. Le ressenti qui résulte d’une ergonomie ratée suffit à faire la mauvaise réputation d’un logiciel et son échec.
Affordance
Le mot « affordance » est de création récente. Si le mot est étrange, sa signification est très simple : l’affordance est la capacité d’un objet à suggérer par sa seule apparence ce à quoi il sert et la façon dont on doit l’utiliser. Un objet ou une interface informatique parfaitement affordants n’ont pas besoin de notice d’utilisation.
La contre affordance, ou affordance trompeuse est fort heureusement rare mais elle peut être extrêmement dommageable, il s’agit d’un objet qui suggère une utilisation différente de la réalité. Voici un exemple simpliste (et inoffensif !) : ce lien est une affordance trompeuse, c’est juste du texte de couleur bleue et souligné !
La démarche d’analyse fonctionnelle dans le projet d’innovation
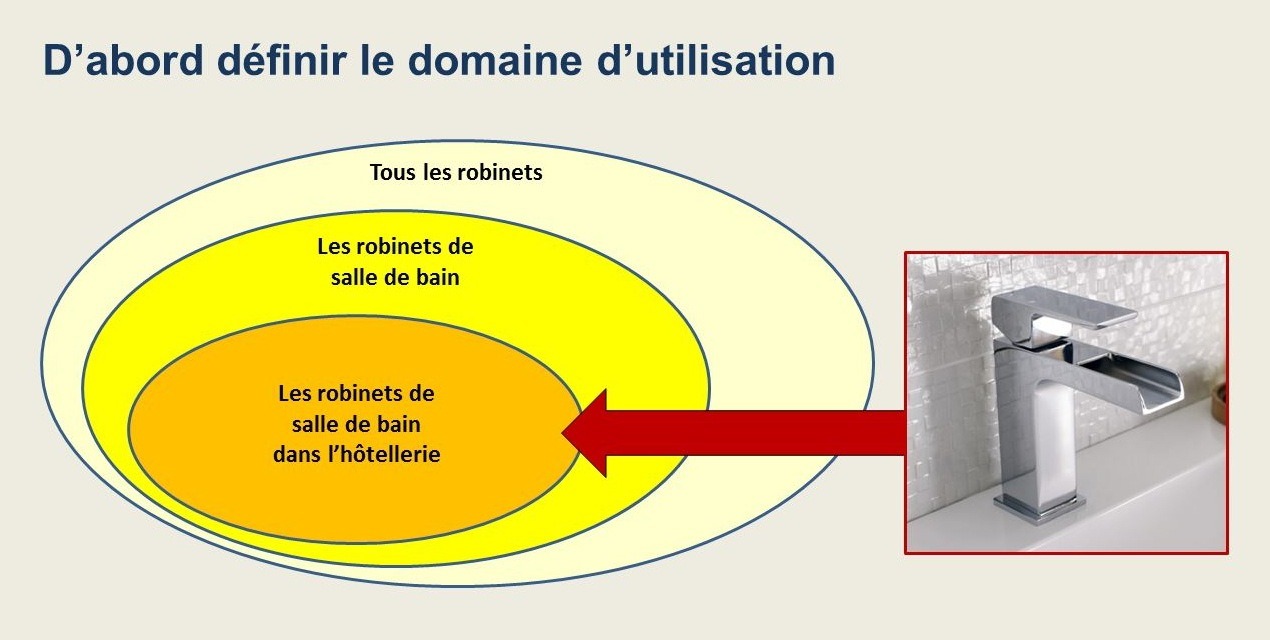 Avant d’aborder l’analyse fonctionnelle proprement dite, assurez-vous d’avoir bien délimité le périmètre d’utilisation du produit. Cela vous évitera beaucoup d’errements par la suite.
Avant d’aborder l’analyse fonctionnelle proprement dite, assurez-vous d’avoir bien délimité le périmètre d’utilisation du produit. Cela vous évitera beaucoup d’errements par la suite.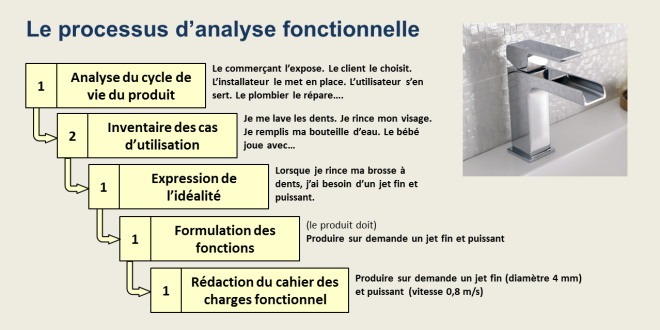 Procéder à l’analyse fonctionnelle externe d’un produit c’est comme faire une enquête de police : cela demande une rigueur extrême. Pour comprendre cela il faut savoir que tout produit aussi basique soit-il comporte au minimum une cinquantaine de fonctions et que l’oubli d’une seule d’entre elles est un jour ou l’autre source d’incidents voire d’accidents et de procès toujours très pénalisants économiquement et en terme d’image. Comment éviter ce risque ? En adoptant, donc, la démarche rigoureuse décrite par ce schéma. Nous allons en détailler ci-après les différentes étapes. L’exemple de l’illustration est un un robinet de lavabo de salle de bain. Une seule fonction a été retenue dans l’exemple parmi les dizaines auxquelles doit satisfaire ce produit.
Procéder à l’analyse fonctionnelle externe d’un produit c’est comme faire une enquête de police : cela demande une rigueur extrême. Pour comprendre cela il faut savoir que tout produit aussi basique soit-il comporte au minimum une cinquantaine de fonctions et que l’oubli d’une seule d’entre elles est un jour ou l’autre source d’incidents voire d’accidents et de procès toujours très pénalisants économiquement et en terme d’image. Comment éviter ce risque ? En adoptant, donc, la démarche rigoureuse décrite par ce schéma. Nous allons en détailler ci-après les différentes étapes. L’exemple de l’illustration est un un robinet de lavabo de salle de bain. Une seule fonction a été retenue dans l’exemple parmi les dizaines auxquelles doit satisfaire ce produit.Du cycle de vie aux cas d’utilisation
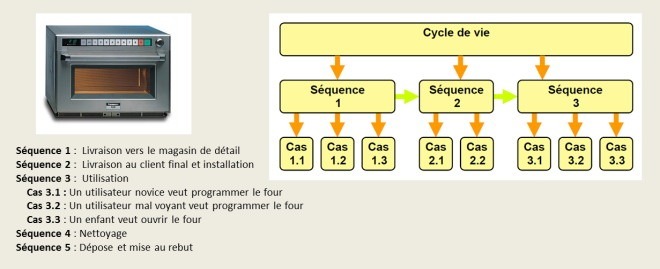 La première étape du processus d’analyse fonctionnelle consiste à faire l’inventaire des différentes situations d’emploi du futur produit. Rien de bien compliqué mais cette étape est néanmoins essentielle. Commençons par le cycle de vie : il s’agit de la suite des situations (séquences) que rencontrera successivement le produit au cours du temps, entre sa « venue au monde » et son retrait du service quelques jours, semaines, années ou décennies plus tard. Attention, le but final de ce travail est de déterminer les fonctions que doit assurer le produit. Alors ne faites pas l’erreur qui consiste à inclure la phase de fabrication du produit dans le cycle de vie. Ce serait un total contre-sens, un produit n’est pas fait pour être fabriqué mais pour être…….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
La première étape du processus d’analyse fonctionnelle consiste à faire l’inventaire des différentes situations d’emploi du futur produit. Rien de bien compliqué mais cette étape est néanmoins essentielle. Commençons par le cycle de vie : il s’agit de la suite des situations (séquences) que rencontrera successivement le produit au cours du temps, entre sa « venue au monde » et son retrait du service quelques jours, semaines, années ou décennies plus tard. Attention, le but final de ce travail est de déterminer les fonctions que doit assurer le produit. Alors ne faites pas l’erreur qui consiste à inclure la phase de fabrication du produit dans le cycle de vie. Ce serait un total contre-sens, un produit n’est pas fait pour être fabriqué mais pour être…….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
La rosace d’interactions
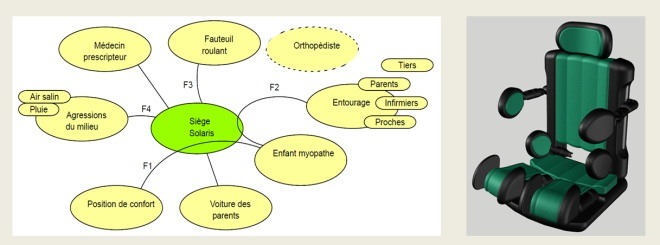 La plupart des élèves de l’enseignement technique ont été initiés à l’analyse fonctionnelle. Tous se souviennent de la « Pieuvre », le nom familier de la rosace d’interaction. Cet outil, en plus de permettre l’identification des fonctions du produit, présente l’intérêt pédagogique de bien faire comprendre la philosophie de l’approche fonctionnelle. La bulle centrale du schéma représente le produit. Les bulles présentes en périphérie représentent les éléments qui se trouvent à un moment donnée du cycle de vie en interaction avec le produit. Autrement dit les « interacteurs ». Tout ce qui est susceptible d’interagir avec le produit est concerné : des personnes (un utilisateur, un voleur…) , des parties du corps humains (la main, l’œil…), des éléments climatiques (le vent, le brouillard, les ultra-violets…), des animaux, des objets, des éléments chimiques ou physiques, etc… Pour finir le groupe de travail va s’attacher à décrire sous la forme de fonctions (ce que fait le produit) les interactions dans lesquelles le produit intervient.
La plupart des élèves de l’enseignement technique ont été initiés à l’analyse fonctionnelle. Tous se souviennent de la « Pieuvre », le nom familier de la rosace d’interaction. Cet outil, en plus de permettre l’identification des fonctions du produit, présente l’intérêt pédagogique de bien faire comprendre la philosophie de l’approche fonctionnelle. La bulle centrale du schéma représente le produit. Les bulles présentes en périphérie représentent les éléments qui se trouvent à un moment donnée du cycle de vie en interaction avec le produit. Autrement dit les « interacteurs ». Tout ce qui est susceptible d’interagir avec le produit est concerné : des personnes (un utilisateur, un voleur…) , des parties du corps humains (la main, l’œil…), des éléments climatiques (le vent, le brouillard, les ultra-violets…), des animaux, des objets, des éléments chimiques ou physiques, etc… Pour finir le groupe de travail va s’attacher à décrire sous la forme de fonctions (ce que fait le produit) les interactions dans lesquelles le produit intervient.Nous avons insisté sur l’intérêt pédagogique de l’outil. Lorsqu’on sait que tout produit assure des dizaines ou des centaines de fonctions on peut être plus réservé sur son intérêt opérationnel dans un vrai travail industriel d’analyse fonctionnelle. A titre personnel je lui préfère une approche par « récits utilisateurs »
Idéalité et récits utilisateurs
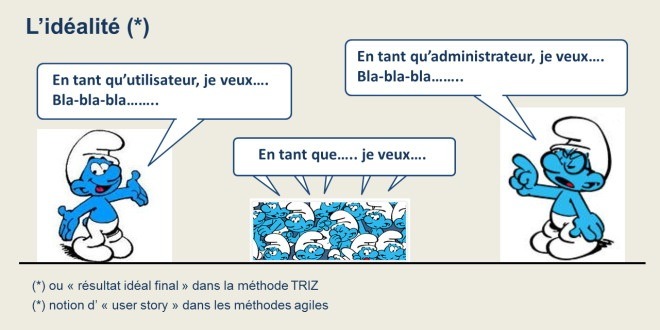 Classiquement, lorsqu’on procède à l’étude d’un nouveau produit industriel il arrive un moment ou l’on va s’efforcer d’énoncer les fonctions du produit, c’est à dire à faire la liste de ce que « fait » le produit. Si l’on prend l’exemple d’un robinet de salle de bain cela peut donner : (le produit doit) délivrer de l’eau à la température souhaitée, être sans danger pour un enfant, résister au vandalisme, être démontable facilement, etc… Cette approche est excellente et elle reste incontournable. Son défaut est de d’être très abstraite et de ce fait de nécessiter une équipe habituée à sa manipulation. Les informaticiens ont introduit avec les « méthodes agiles » la notion d’user stories (récits utilisateurs en bon français). Le principe consiste plutôt que d’exprimer ce que fait le produit de décrire ce que souhaite l’utilisateur en terme d’usage. Les récits utilisateurs sont des phrases construites sous la forme « en tant que …….. je veux….. dans le but de……. » Appliqué à notre robinetterie de salle de bain cela pourrait donner : « en tant que responsable de maintenance je souhaite un démontage rapide dans le but de gagner du temps » ou « en tant que gestionnaire de l’hôtel je souhaite un robinet anti-vandalisme dans le but de limiter les coûts de maintenance » Cette approche est plus intuitive et autorise de ce fait un travail d’investigation plus fluide et plus rapide. Charge aux techniciens à transformer ensuite ces propositions en fonctions.
Classiquement, lorsqu’on procède à l’étude d’un nouveau produit industriel il arrive un moment ou l’on va s’efforcer d’énoncer les fonctions du produit, c’est à dire à faire la liste de ce que « fait » le produit. Si l’on prend l’exemple d’un robinet de salle de bain cela peut donner : (le produit doit) délivrer de l’eau à la température souhaitée, être sans danger pour un enfant, résister au vandalisme, être démontable facilement, etc… Cette approche est excellente et elle reste incontournable. Son défaut est de d’être très abstraite et de ce fait de nécessiter une équipe habituée à sa manipulation. Les informaticiens ont introduit avec les « méthodes agiles » la notion d’user stories (récits utilisateurs en bon français). Le principe consiste plutôt que d’exprimer ce que fait le produit de décrire ce que souhaite l’utilisateur en terme d’usage. Les récits utilisateurs sont des phrases construites sous la forme « en tant que …….. je veux….. dans le but de……. » Appliqué à notre robinetterie de salle de bain cela pourrait donner : « en tant que responsable de maintenance je souhaite un démontage rapide dans le but de gagner du temps » ou « en tant que gestionnaire de l’hôtel je souhaite un robinet anti-vandalisme dans le but de limiter les coûts de maintenance » Cette approche est plus intuitive et autorise de ce fait un travail d’investigation plus fluide et plus rapide. Charge aux techniciens à transformer ensuite ces propositions en fonctions.L’arbre fonctionnel
 Nous voici au bout d’un travail d’investigation long mais indispensable : nous avons élaboré la liste impressionnante des fonctions que doit satisfaire le futur produit. Il reste deux choses à faire pour en avoir terminé avec l’analyse fonctionnelle externe : organiser cette liste et affecter chaque fonction des éléments quantitatifs qui permettrons de déterminer sans discussion possible si telle ou telle fonction du produit réel (par exemple un prototype) est assurée ou pas. Ordonner la liste des fonctions c’est construire une Nous voici au bout d’un travail d’investigation long mais indispensable : nous avons élaboré la liste impressionnante des fonctions que doit satisfaire le futur produit. Il reste deux choses à faire pour en avoir terminé avec l’analyse fonctionnelle externe : organiser cette liste et affecter chaque fonction des éléments quantitatifs qui permettrons de déterminer sans discussion possible si telle ou telle fonction du produit réel (par exemple un prototype) est assurée ou pas. Ordonner la liste des fonctions c’est construire une arborescence à deux ou trois niveaux, un « arbre fonctionnel ». Au premier niveau de l’arbre on trouve souvent une structure telle que celle-ci :
Nous voici au bout d’un travail d’investigation long mais indispensable : nous avons élaboré la liste impressionnante des fonctions que doit satisfaire le futur produit. Il reste deux choses à faire pour en avoir terminé avec l’analyse fonctionnelle externe : organiser cette liste et affecter chaque fonction des éléments quantitatifs qui permettrons de déterminer sans discussion possible si telle ou telle fonction du produit réel (par exemple un prototype) est assurée ou pas. Ordonner la liste des fonctions c’est construire une Nous voici au bout d’un travail d’investigation long mais indispensable : nous avons élaboré la liste impressionnante des fonctions que doit satisfaire le futur produit. Il reste deux choses à faire pour en avoir terminé avec l’analyse fonctionnelle externe : organiser cette liste et affecter chaque fonction des éléments quantitatifs qui permettrons de déterminer sans discussion possible si telle ou telle fonction du produit réel (par exemple un prototype) est assurée ou pas. Ordonner la liste des fonctions c’est construire une arborescence à deux ou trois niveaux, un « arbre fonctionnel ». Au premier niveau de l’arbre on trouve souvent une structure telle que celle-ci :Le produit doit être …
– apte à l’usage, satisfaire aux exigences primaires du client-utilisateur
– adapté aux conditions d’utilisation, à l’environnement.
– confortable, ergonomique
– Etre…….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
Le Cahier des Charges Fonctionnel (CDCF) référentiel du besoin
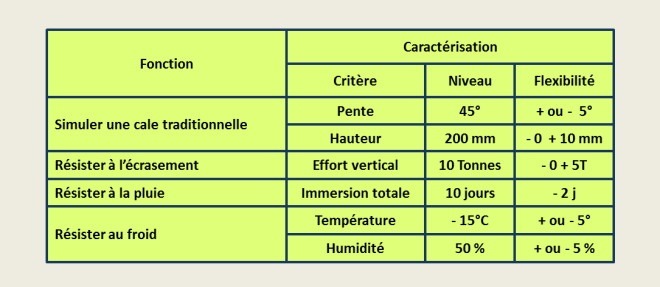 Le cahier des charges fonctionnel (ou CDCF) est un arbre fonctionnel auquel on a rajouté les éléments quantitatifs permettant de spécifier pour chaque fonction le niveau de performance attendu.
Le cahier des charges fonctionnel (ou CDCF) est un arbre fonctionnel auquel on a rajouté les éléments quantitatifs permettant de spécifier pour chaque fonction le niveau de performance attendu.L’utilité du cahier des charges fonctionnel va bien au delà du seul cadre du projet d’innovation. Voici les principaux usages et qualités du CDCF :
– Formaliser le besoin du Client-Utilisateur.
– Servir de document de référence pour tout projet (c’est le référentiel du besoin).
– Inciter au dialogue entre les acteurs du projet car il est rédigé dans un langage compréhensible par tous.
– Favoriser la créativité car s’il est bien rédigé il ne propose ni ne suggère aucune solution.
– Dans les relations contractuelles entre fournisseur et client, il prévient …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
- Le processus de développement du produit
- La Conception à Coût Objectif (CCO)
- La Conception à Coût Global Objectif (CCGO)
- L’Analyse de la Valeur (AV)
- Comment réduire les coûts en conception
Le processus de développement du produit
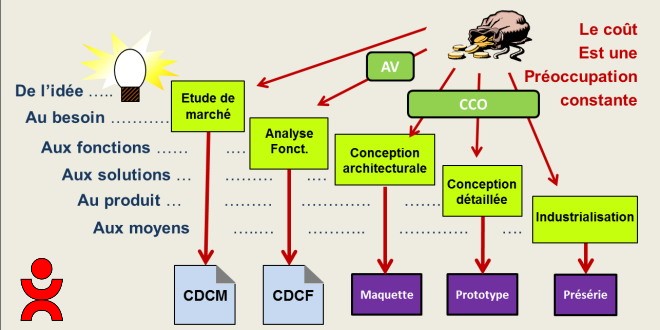 Prenons un peu de recul et envisageons le processus de conception du produit dans son intégralité. Décrivons le schéma ci-contre en partant de la gauche. Nous avons montré dans une leçon précédente l’importance de commencer par une approche marketing. Le document de sortie de cette étude est le cahier des charges marketing (CDCM). Ce document sert de donnée d’entrée de l’analyse fonctionnelle externe que nous venons de décrire et qui se conclue par le cahier des charges fonctionnel (CDCF). L’étape suivante du processus consiste à définir les principes qui seront mis en œuvre dans le produit, et l’architecture générale de celui-ci. Il est important à ce stade de visualiser le concept. C’est ce à quoi servent les maquettes, réelles ou virtuelles. Vient ensuite le moment de l’étude détaillée qui trouvera sa concrétisation dans un prototype. C’est ce prototype qui va permettre de vérifier si les fonctions du cahier des charges fonctionnel sont effectivement réalisées. Dès lors commence la phase d’industrialisation qui consiste à mettre en place les moyens matériels, humains et organisationnels qui permettrons d’alimenter le marché. Généralement une pré-série permet de produire quelques dizaines de produits qui seront soumis pour certains à la torture et pour d’autres confiés à une élite d’utilisateurs pionniers.
Prenons un peu de recul et envisageons le processus de conception du produit dans son intégralité. Décrivons le schéma ci-contre en partant de la gauche. Nous avons montré dans une leçon précédente l’importance de commencer par une approche marketing. Le document de sortie de cette étude est le cahier des charges marketing (CDCM). Ce document sert de donnée d’entrée de l’analyse fonctionnelle externe que nous venons de décrire et qui se conclue par le cahier des charges fonctionnel (CDCF). L’étape suivante du processus consiste à définir les principes qui seront mis en œuvre dans le produit, et l’architecture générale de celui-ci. Il est important à ce stade de visualiser le concept. C’est ce à quoi servent les maquettes, réelles ou virtuelles. Vient ensuite le moment de l’étude détaillée qui trouvera sa concrétisation dans un prototype. C’est ce prototype qui va permettre de vérifier si les fonctions du cahier des charges fonctionnel sont effectivement réalisées. Dès lors commence la phase d’industrialisation qui consiste à mettre en place les moyens matériels, humains et organisationnels qui permettrons d’alimenter le marché. Généralement une pré-série permet de produire quelques dizaines de produits qui seront soumis pour certains à la torture et pour d’autres confiés à une élite d’utilisateurs pionniers.Ce schéma va nous permettre d’introduire les outils qui vont être décrits plus bas, et surtout insister sur l’un des principaux facteurs de succès d’un projet d’innovation : prendre en compte la contrainte de coût le plus tôt possible et ne jamais la perdre de vue. Un grand nombre de produits industriels souffrent d’être trop couteux à fabriquer, et ceci pour une raison bien simple : ceux qui les ont dessinés ignoraient l’incidence en terme de dépenses à venir de chacun de leurs choix technologiques. Il y a deux outils méthodologiques qui répondent à cette nécessité de prise en compte des coûts : la conception à coût objectif (CCO) et l’analyse de la valeur (AV). Ces deux outils sont décrits ci-après.
La Conception à Coût Objectif (CCO)
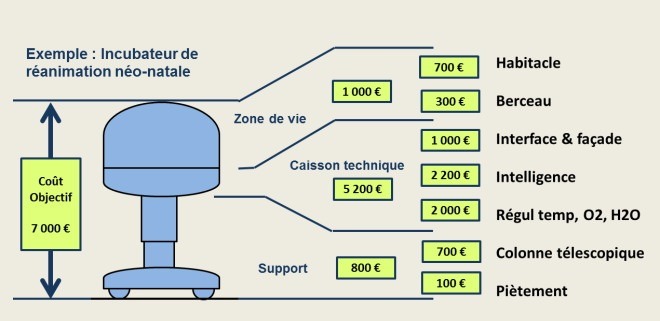 Le schéma ci-contre est une représentation simplifiée d’un produit bien réel : un incubateur de réanimation néo-natale, vulgairement appelé une « couveuse ». Cet exemple va nous permettre d’illustrer le concept de conception à coût objectif (CCO). L’exemple est réel mais les chiffres sont faux pour des raisons naturelles de confidentialité. Avant de décrire la méthode, je souhaiterais en justifier l’existence.
Le schéma ci-contre est une représentation simplifiée d’un produit bien réel : un incubateur de réanimation néo-natale, vulgairement appelé une « couveuse ». Cet exemple va nous permettre d’illustrer le concept de conception à coût objectif (CCO). L’exemple est réel mais les chiffres sont faux pour des raisons naturelles de confidentialité. Avant de décrire la méthode, je souhaiterais en justifier l’existence.Pourquoi la conception classique coute-t-elle cher ?
Voici cinq raisons qui expliquent qu’un ingénieur ou un technicien de bureau d’études est naturellement porté à concevoir des produits trop chers :
1- En général il manque de temps pour chercher des solutions astucieuses et économiques.
2- Pour chaque fonctions, il a SA solution habituelle, conforme aux …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
La Conception à Coût Global Objectif (CCGO)
 En matière de biens durables on peut distinguer deux types de comportement d’achat : Certains acheteurs font un raisonnement de court terme et déterminent leur choix en fonction du seul prix de vente du produit. D’autres, et c’est cette catégorie qui nous intéresse dans ce paragraphe, font un raisonnent sur le long terme. Les trois exemples du schéma en sont l’illustration : une compagnie aérienne, un industriel sérieux qui fait l’acquisition d’un chariot élévateur et une fraction des acheteurs de véhicules automobiles prennent en compte la totalité des coûts engendrés par leur achat et pas seulement le prix d’achat. Symétriquement le concepteur de tels produits doit faire ses choix de conception non pas avec comme unique objectif de diminuer le coût de revient mais avec le double objectif de maîtriser le coût de production ET les coûts d’exploitation.
En matière de biens durables on peut distinguer deux types de comportement d’achat : Certains acheteurs font un raisonnement de court terme et déterminent leur choix en fonction du seul prix de vente du produit. D’autres, et c’est cette catégorie qui nous intéresse dans ce paragraphe, font un raisonnent sur le long terme. Les trois exemples du schéma en sont l’illustration : une compagnie aérienne, un industriel sérieux qui fait l’acquisition d’un chariot élévateur et une fraction des acheteurs de véhicules automobiles prennent en compte la totalité des coûts engendrés par leur achat et pas seulement le prix d’achat. Symétriquement le concepteur de tels produits doit faire ses choix de conception non pas avec comme unique objectif de diminuer le coût de revient mais avec le double objectif de maîtriser le coût de production ET les coûts d’exploitation.Cette logique est illustrée par la figure métaphorique de l’iceberg des coûts. Chacun sait que 10% seulement de la masse de l’iceberg émerge de la surface de l’océan. Même si la proportion n’est pas forcément la même il en est de même pour le coût d’un bien durable.
L’Analyse de la Valeur (AV)
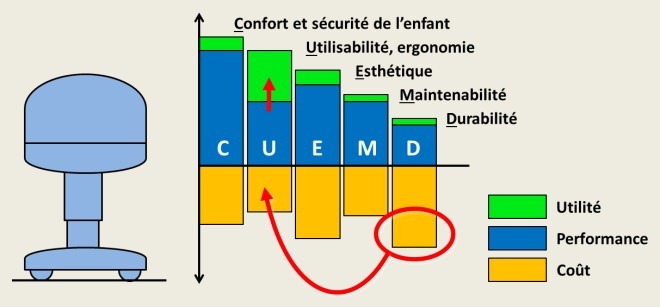 L’analyse de la Valeur est une méthode de conception (et surtout de re-conception) de produit qui vise à minimiser le coût tout en maximisant la satisfaction de l’utilisateur. Un peu d’histoire pour commencer. Lawrence D. Miles, Ingénieur chez Général Electric, crée l’Analyse de la valeur dans les années 1940. Au cours de la décennie 1960 Le ministère de la défense US impose à ses fournisseurs d’utiliser cette méthode. A la même époque la France découvre à son tour l’Analyse de la Valeur. Outre sa puissance en matière d’optimisation du produit, l’analyse de la valeur change radicalement le regard des concepteurs sur le produit et son utilité. Pour un « AViste », le produit n’est rien d’autre que le support des fonctions de service. Cette vision différente est à elle seule une grande force.
L’analyse de la Valeur est une méthode de conception (et surtout de re-conception) de produit qui vise à minimiser le coût tout en maximisant la satisfaction de l’utilisateur. Un peu d’histoire pour commencer. Lawrence D. Miles, Ingénieur chez Général Electric, crée l’Analyse de la valeur dans les années 1940. Au cours de la décennie 1960 Le ministère de la défense US impose à ses fournisseurs d’utiliser cette méthode. A la même époque la France découvre à son tour l’Analyse de la Valeur. Outre sa puissance en matière d’optimisation du produit, l’analyse de la valeur change radicalement le regard des concepteurs sur le produit et son utilité. Pour un « AViste », le produit n’est rien d’autre que le support des fonctions de service. Cette vision différente est à elle seule une grande force.La méthode AV est classiquement décrite comme la succession de 7 phases :
1- Orientation de l’action
2- Recherche de l’information
3- Analyse fonctionnelle. Analyse des coûts. Analyse fonctions/performance/coûts
4- Recherche d’idées et voies de solutions
5- Étude et évaluation des solutions
6- Bilan prévisionnel et décisions
7- Réalisation et bilan définitif
L’Analyse de la Valeur se pratique en …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
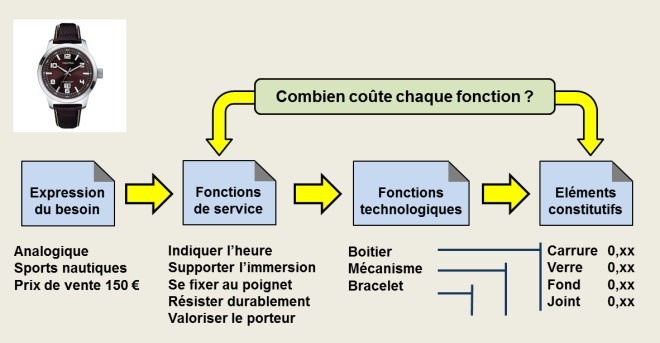 Voici un autre exemple de produit : une montre-bracelet dédiée aux sports nautiques. Il illustre la principale difficulté de l’analyse de la valeur : calculer le coût de chaque fonction. Tout service méthode bien organisé est capable de vous indiquer avec beaucoup de précision le coût de chaque élément constitutif du produit (ici la montre). La difficulté du calcul du coût des fonctions provient du constat que la plupart du temps le même élément constitutif (par exemple le verre de la montre) contribue à plusieurs fonctions (éviter que l’eau ne pénètre dans le mécanisme, résister aux chocs, résister aux rayures, etc..). La clé du problème réside dans la bonne utilisation de la « matrice de transfert des coûts » décrite ci-dessous.
Voici un autre exemple de produit : une montre-bracelet dédiée aux sports nautiques. Il illustre la principale difficulté de l’analyse de la valeur : calculer le coût de chaque fonction. Tout service méthode bien organisé est capable de vous indiquer avec beaucoup de précision le coût de chaque élément constitutif du produit (ici la montre). La difficulté du calcul du coût des fonctions provient du constat que la plupart du temps le même élément constitutif (par exemple le verre de la montre) contribue à plusieurs fonctions (éviter que l’eau ne pénètre dans le mécanisme, résister aux chocs, résister aux rayures, etc..). La clé du problème réside dans la bonne utilisation de la « matrice de transfert des coûts » décrite ci-dessous. La matrice de transfert des coûts est l’outil central de la démarche d’analyse de la valeur. L’élaboration de ce document demande une quantité de travail à ne pas négliger. La motivation du groupe devra être assez forte pour supporter ce pensum. L’animateur devra disposer d’une bonne capacité de persuasion et d’une patience de Bénédictin pour rappeler sans cesse les règles de répartition à un groupe en général pressé d’en finir.
La matrice de transfert des coûts est l’outil central de la démarche d’analyse de la valeur. L’élaboration de ce document demande une quantité de travail à ne pas négliger. La motivation du groupe devra être assez forte pour supporter ce pensum. L’animateur devra disposer d’une bonne capacité de persuasion et d’une patience de Bénédictin pour rappeler sans cesse les règles de répartition à un groupe en général pressé d’en finir.Le processus de répartition des coûts est itératif, il consiste à travailler élément par élément, à partir du plus petit niveau de décomposition du produit. Le coût de chaque élément est distribué entre les différentes fonctions auxquelles il contribue.
La grande question est la suivante : « sachant que tel élément, dont on connaît le coût, contribue à plusieurs fonctions, en fonction de quelle logique peut-on distribuer ce coût sur les différentes fonctions impactées ».
Les enseignants en analyse de la valeur proposent le plus souvent l’une ou l’autre de ces deux méthodes :
1) Diviser le coût de l’élément par le nombre de fonctions auxquelles il contribue.
2) Distribuer le coût au prorata de …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
Comment réduire les coûts en conception
Pour finir voici quelques pistes et conseils pour concevoir des produits moins chers et plus performants :
Prendre en compte l’industrialisation dès la conception du produit
– Concevoir simple c’est bien, mais il faut intégrer les contraintes de fabrication lors de la conception : formats standards de matière, composants économiques, etc…
Miniaturiser
– Pour des produits simples, la miniaturisation un effet mécanique sur les coûts : moins de matière, moins de transport… Mais attention sur des produits très techniques (électronique) l’effet joue à l’inverse
Regrouper plusieurs éléments en un seul
– Par exemple en mécanique, remplacer un ensemble mécano-soudé par une pièce de fonderie.
– Dans les plastiques, on sait faire assurer par une seule pièce sa fonction principale plus les fonctions charnière, ressort, fermeture.. (coffrets, mallettes, bouchons…)
Lorsqu’un élément coûteux remplit plusieurs fonctions, le remplacer par plusieurs éléments
– En cuisine, remplacer un…….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous
Sommaire de la leçon :
- Vue d’ensemble de la propriété intellectuelle
- Les créations non protégeables
- La protection des œuvres de l’esprit
- La protection des signes distinctifs
- Les dessins et modèles
- Le brevet d’invention dans le projet d’innovation
- L’enveloppe Soleau
- Le cas particulier des logiciels
- En pratique …
Pour accéder à la vidéo en version intégrale (26 minutes) Je m’abonne. ou Je me connecte
Vue d’ensemble de la propriété intellectuelle
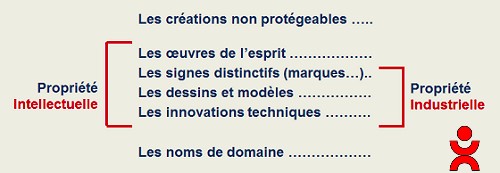 La question de la protection de votre innovation est régie par le code de la propriété intellectuelle. Le législateur a organisé la propriété intellectuelle en 4 domaines, comme indiqué sur l’image.
La question de la protection de votre innovation est régie par le code de la propriété intellectuelle. Le législateur a organisé la propriété intellectuelle en 4 domaines, comme indiqué sur l’image.– Le projet d’innovation est plus particulièrement concernée par les trois domaines regroupés sous l’intitulé « propriété industrielle ». La protection des œuvres de l’esprit sera tout de même développée un peu plus loin car elle peut concerner au moins en partie certains projets d’innovation.
– Plus récemment apparus, les nom de domaine internet jouissent du régime très simple que l’on peut résumer sous la forme « premier entré, premier servi »
Les créations non protégeables
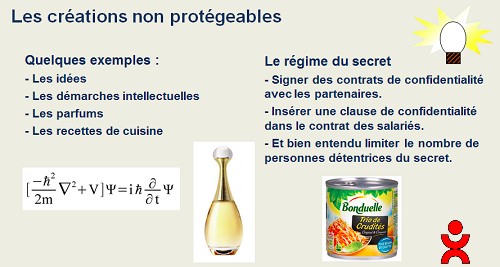 Voici l’occasion de faire tomber l’une des nombreuses idées fausses sur la protection intellectuelle. Combien de fois on entend un entrepreneur annoncer « j’ai une idée (d’un nouveau produit, d’un concept révolutionnaire…) je vais déposer une enveloppe Soleau. » Totalement inutile ! notre entrepreneur aura l’illusion d’être protégé, mais ne disposera strictement d’aucun recours contre quiconque mettrait cette idée en pratique. Pourquoi ? Tout simplement parce que les idées ne sont pas protégeables. Pas plus que démarches intellectuelles, les parfums et les recettes de cuisine. Imaginez-vous un instant à la place d’un restaurateur obligé de négocier un contrat de licence pour mettre les harengs pomme à l’huile au menu, et de verser des royalties à l’inventeur !
Voici l’occasion de faire tomber l’une des nombreuses idées fausses sur la protection intellectuelle. Combien de fois on entend un entrepreneur annoncer « j’ai une idée (d’un nouveau produit, d’un concept révolutionnaire…) je vais déposer une enveloppe Soleau. » Totalement inutile ! notre entrepreneur aura l’illusion d’être protégé, mais ne disposera strictement d’aucun recours contre quiconque mettrait cette idée en pratique. Pourquoi ? Tout simplement parce que les idées ne sont pas protégeables. Pas plus que démarches intellectuelles, les parfums et les recettes de cuisine. Imaginez-vous un instant à la place d’un restaurateur obligé de négocier un contrat de licence pour mettre les harengs pomme à l’huile au menu, et de verser des royalties à l’inventeur !Quelle solution, alors ? D’abord garder le secret sur votre idée aussi longtemps que possible, puis avoir toujours une longueur d’avance sur vos concurrents. N’est-ce pas ce que font les grands cuisiniers, pour le plus grand bien de la gastronomie en général, et de nos papilles en particulier.
La protection des œuvres de l’esprit
 Voici sur la liste ci-contre le détail de ce que l’on regroupe sous le nom d’œuvres de l’esprit. La protection de ces créations est le domaine du « droit d’auteur« . Si vous êtes l’auteur d’un livre, d’une chanson ou de toute autre création littéraire, artistique ou scientifique, il vous appartient de rechercher les éventuels « copieurs » (aucune administration ne fera ce travail à votre place, encore une idée reçue !) puis de le poursuivre devant la justice. Vous ne gagnerez le procès que si vous produisez devant le juge la preuve que vous êtes bien l’auteur et si les analogies entre votre œuvre et la copie sont jugées assez évidentes pour que le plagiat soit établi. En résumé : Constituez des preuves incontestables de votre propriété, et surveillez la production des éventuels copieurs.
Voici sur la liste ci-contre le détail de ce que l’on regroupe sous le nom d’œuvres de l’esprit. La protection de ces créations est le domaine du « droit d’auteur« . Si vous êtes l’auteur d’un livre, d’une chanson ou de toute autre création littéraire, artistique ou scientifique, il vous appartient de rechercher les éventuels « copieurs » (aucune administration ne fera ce travail à votre place, encore une idée reçue !) puis de le poursuivre devant la justice. Vous ne gagnerez le procès que si vous produisez devant le juge la preuve que vous êtes bien l’auteur et si les analogies entre votre œuvre et la copie sont jugées assez évidentes pour que le plagiat soit établi. En résumé : Constituez des preuves incontestables de votre propriété, et surveillez la production des éventuels copieurs.La protection des signes distinctifs
 Vous avez créé, seul ou avec l’aide d’un homme de l’art, une marque, un logo, ou tout autre signe distinctif de votre activité commerciale, vous avez deux choses à faire :
Vous avez créé, seul ou avec l’aide d’un homme de l’art, une marque, un logo, ou tout autre signe distinctif de votre activité commerciale, vous avez deux choses à faire :– Vérifier ou faire vérifier par un expert que vous n’êtes pas en train de contrefaire, même à votre insu, la propriété d’un possible concurrent.
– Déposer votre création auprès de l’INPI (Institut National de Propriété Intellectuelle.
Les dessins et modèles
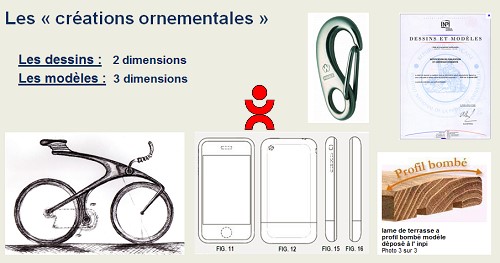 Les média ont popularisé la question de la contrefaçon. Qui n’a pas vu des reportages télévisés sur la traque des faux sacs Vuitton dans les halls de transit de marchandises des aéroports ou la destruction à grand spectacles de milliers de montres au rouleau compresseur ? La contrefaçon ne concerne pas que les produits de luxe, loin de là : tout industriel qui commercialise un produit est susceptible d’être copié par un concurrent, qui va mettre sur le marché un produit suffisamment ressemblant pour créer la confusion chez le client. Le copieur aura toute les chances de capter une partie du marché alors qu’il a fait l’économie de l’effort de création et du risque associé. La solution ? déposer dessins et modèles de votre produit auprès de l’INPI, puis surveiller les concurrents et attaquer en justice celui d’entre eux qui mettrait sur le marché un produit trop ressemblant.
Les média ont popularisé la question de la contrefaçon. Qui n’a pas vu des reportages télévisés sur la traque des faux sacs Vuitton dans les halls de transit de marchandises des aéroports ou la destruction à grand spectacles de milliers de montres au rouleau compresseur ? La contrefaçon ne concerne pas que les produits de luxe, loin de là : tout industriel qui commercialise un produit est susceptible d’être copié par un concurrent, qui va mettre sur le marché un produit suffisamment ressemblant pour créer la confusion chez le client. Le copieur aura toute les chances de capter une partie du marché alors qu’il a fait l’économie de l’effort de création et du risque associé. La solution ? déposer dessins et modèles de votre produit auprès de l’INPI, puis surveiller les concurrents et attaquer en justice celui d’entre eux qui mettrait sur le marché un produit trop ressemblant.Le brevet d’invention dans le projet d’innovation
 Encore quelques idées reçues, celles-ci sur le brevet d’invention :
Encore quelques idées reçues, celles-ci sur le brevet d’invention :– « Mon produit est innovant, donc je peux le breveter » FAUX : la nouveauté n’est pas un critère suffisant.
– « Ma demande de brevet a été acceptée, donc mon idée est validée par l’institution » FAUX, bien que ce soit l’argument de pas mal d’illuminés !
– « L’INPI me protège des contrefacteurs éventuels » FAUX, l’INPI se borne à enregistrer les brevets et les rendre accessibles au public.
Alors quelle est la réalité ? D’abord on brevète une invention et pas un produit. Une invention est la réponse technique à un problème technique bien identifié. Pour être brevetable, l’invention doit être nouvelle, susceptible d’application industrielle et originale (au sens ou une solution trop évidente n’est pas brevetable). Contrairement aux autres dispositifs de la protection intellectuelle, la procédure de dépôt de brevet est lourde et couteuse (de 5 000 à plusieurs centaines de milliers d’euro). Pour vous faire une idée de ce à quoi ressemble un brevet, il vous suffit d’aller sur la base européenne des brevets www.espacenet.com Base européenne des brevets et de lancer une recherche.
Le cycle de vie du brevet
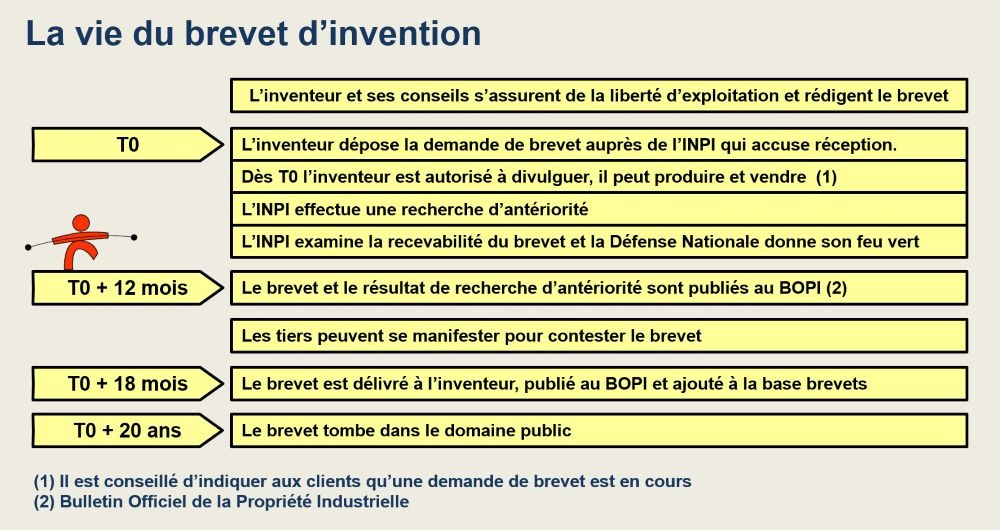 Le schéma ci-contre résume les différentes étapes de la vie du brevet, depuis la conception du produit jusqu’au moment ou ce même brevet tombe dans le domaine public, au bout de 20 ans (dans le cas général).
Le schéma ci-contre résume les différentes étapes de la vie du brevet, depuis la conception du produit jusqu’au moment ou ce même brevet tombe dans le domaine public, au bout de 20 ans (dans le cas général).Voici quelques commentaires sur ce schéma.
– Dans un premier temps c’est bien entendu au concepteur d’imaginer un dispositif suffisamment original pour être brevetable. A ce stade on ne peut que fortement conseiller à l’inventeur de se rapprocher d’un conseiller en propriété industrielle. En effet, tant la recherche d’antériorité que la rédaction du brevet sont des activités très techniques qui demandent une compétence pointue.
– L’inventeur (et/ou son représentant) dépose le brevet à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). Ce dernier accuse réception de la demande (ce qui ne préjuge en rien de la validité du brevet). S’engage alors une période de 18 mois qui correspond à l’instruction du dossier. Il est important de préciser qu’à compter de la date de dépôt l’inventeur peut librement communiquer sur son invention, produire et commercialiser. L’INPI conseille d’informer les clients qu’un dépot de brevet est en cours, ceci pour décourager toute velléité de copie. Pendant les 12 premiers mois l’INPI effectue sa propre recherche d’antériorité et examine la recevabilité de la demande de brevet. La Défense nationale (Direction Générale de l’Armement) est consultée par l’INPI et peut imposer des restrictions dans l’un des deux cas suivants : 1) l’invention présente un intérêt pour la défense ou la sécurité nationale, 2) la divulgation de l’invention peut porter préjudice à la défense ou la sécurité nationale. Pour plus de détails sur ce point particulier, consultez ce guide (au format PDF) publié par la DGA.
– A l’issue des 12 mois d’instruction le brevet et le résultat de la recherche d’antériorité sont publiés au BOPI (Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle). Les tiers qui voudraient faire opposition au brevet ont 6 mois pour se manifester auprès de l’INPI, qui examine leurs arguments et tranche sur leur validité.
– Si aucune réclamation recevable n’a été constatée au bout de 6 mois, le brevet est définitivement accordé. Il est ajouté à la base de brevets et publié au BOPI.
– La durée de validité du brevet est de 20 ans à compter de la date de dépôt. Contrairement à d’autres outils de propriété industrielle le brevet n’est pas renouvelable, il tombe irrémédiablement dans le domaine public. Quiconque peut alors commercialiser des produits mettant en oeuvre l’invention.
La brevetabilité des logiciels
Le système de brevets actuel a été en grande partie élaboré au cours du 19° siècle, plus d’un siècle avant l’apparition des premiers ordinateurs. Inutile de dire que les offices nationaux des brevets ont été pris de court par les premières demandes de brevet portant sur des logiciels. Après des décennies de décisions à géométrie variable, les règles quant à la brevetabilité des logiciels tendent à s’homogénéiser au niveau mondial. Les principes sont les suivants :
– Un logiciel « en tant que tel » n’est pas brevetable. Il est protégé au titre du droit d’auteur, comme un roman, une chanson ou une photo.
– Le cas est différent pour une « invention mise en œuvre par logiciel ». Autrement dit un dispositif technologique intégrant un logiciel. Voici deux exemple de ce type d’inventions : Le système de freinage ABS. Une machine à voter.
– Dans tous les cas c’est, en France, l’INPI qui détermine si la demande de brevet est recevable ou pas.
L’enveloppe Soleau
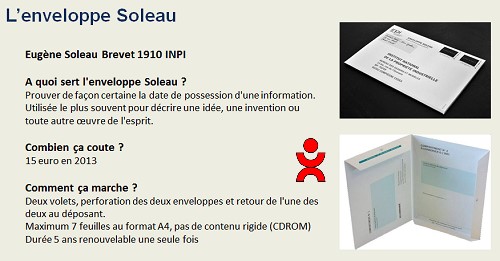 Que de fantasmes sur l’enveloppe Soleau. La protection contre la contrefaçon pour 15 euro seulement ! L’enveloppe Soleau existe, elle coûte bien 15 euro, c’est un très bon outil… Mais n’espérez pas qu’elle va vous protéger aussi bien qu’un brevet qui vous aura couté 15 000 euro ! L’enveloppe Soleau (sous sa forme papier) abrite un maximum de 7 pages au format A4, pas plus, et surtout pas un CDROM qui serait détruit avant même d’être mis en stock. Qu’allez-vous inscrire sur les quelques pages ? La description de votre idée, voire de votre invention, ou le design de votre produit, ou toute autre chose qui vous passe par la tête, de toute façon vous serez seul à savoir ce qu’elle contient, c’est le principe. Où allez-vous déposer votre enveloppe ? à l’INPI. Dans quel but ? Prouver au juge, le jour d’un éventuel procès, que vous étiez bien en possession de ces informations à la date du dépôt de l’enveloppe. Et c’est tout ! Aucune preuve que vous êtes bien le créateur de l’innovation, aucun droit de propriété, aucune possibilité de faire opposition au brevet qu’un tiers aurait déposé. C’est peu, mais pour 15 euro….
Que de fantasmes sur l’enveloppe Soleau. La protection contre la contrefaçon pour 15 euro seulement ! L’enveloppe Soleau existe, elle coûte bien 15 euro, c’est un très bon outil… Mais n’espérez pas qu’elle va vous protéger aussi bien qu’un brevet qui vous aura couté 15 000 euro ! L’enveloppe Soleau (sous sa forme papier) abrite un maximum de 7 pages au format A4, pas plus, et surtout pas un CDROM qui serait détruit avant même d’être mis en stock. Qu’allez-vous inscrire sur les quelques pages ? La description de votre idée, voire de votre invention, ou le design de votre produit, ou toute autre chose qui vous passe par la tête, de toute façon vous serez seul à savoir ce qu’elle contient, c’est le principe. Où allez-vous déposer votre enveloppe ? à l’INPI. Dans quel but ? Prouver au juge, le jour d’un éventuel procès, que vous étiez bien en possession de ces informations à la date du dépôt de l’enveloppe. Et c’est tout ! Aucune preuve que vous êtes bien le créateur de l’innovation, aucun droit de propriété, aucune possibilité de faire opposition au brevet qu’un tiers aurait déposé. C’est peu, mais pour 15 euro….L’enveloppe Soleau est conservée 5 ans, renouvelable par périodes de 5 ans.
– Dématérialisation oblige, l’INPI a mis à disposition un nouveau service nommé e-Soleau, version numérique en ligne de l’enveloppe Soleau. Le prix est identique à la version papier, La capacité est de 50 MO. Plus une somme de 10€ par tranche de 50 MO supplémentaire.
Le cas particulier des logiciels
Ce que dit la loi
Le principe de base est le suivant : Le logiciel est une oeuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur. Autrement dit pas de différence pour le législateur entre un logiciel de comptabilité, un roman de victor Hugo ou une chanson de tel ou tel chanteur de variété.
La question de la brevetabilité des logiciels est traitée plus haut dans le paragraphe sur les brevets. Pour résumer, un logiciel n’est pas brevetable, mais une invention mise en oeuvre par logiciel est brevetable. Si ceci n’est pas assez clair voici quelques exemples d’associations logiciel + dispositif technique : 1) le système de freinage anti-blocage des roues (ABS) est brevetable, de même une télécommande de téléviseur,
Ce paragraphe est forcément simplificateur, les critères de brevetabilité des logiciels évoluent dans le temps et dans les différentes régions du monde. Des dispositifs logiciels ont été brevetés dans le passé (notamment aux Etats-Unis) qui ne pourraient plus l’être aujourd’hui.
Qui est propriétaire des droits sur un logiciel
– En théorie la création appartient au créateur ! donc le logiciel appartient à la personne qui a conçu ce logiciel. Attention, ceci n’est vrai que dans le cas assez rare du développeur indépendant qui exploite lui-même le logiciel dont il est l’auteur.
– Le développeur salarié qui a pour mission de créer un logiciel n’est pas propriétaire des droits sur ce logiciel. La création appartient à l’employeur.
– Le développeur indépendant tout comme la société de service qui développe un logiciel pour le compte d’autrui (et qui sont mandatés et rémunérés pour cela) ne sont pas eux non plus titulaires des droits. Pour éviter tout conflit entre les deux parties contractantes il est prudent de mentionner ceci dans le contrat.
– A plus forte raison l’utilisateur qui a « acheté » tel ou tel logiciel du marché n’est pas propriétaire du logiciel mais seulement d’une licence (autorisation) d’utilisation de ce logiciel. L’utilisateur ne peut ni vendre la licence, ni même la mettre temporairement à la disposition d’autrui. Une entreprise qui veut utiliser le même logiciel simultanément sur plusieurs machines doit acheter autant de licences que de postes de travail équipés.
– Pour finir, les droits intellectuels sont cessibles, pour un logiciel comme pour toute autre création intellectuelle.
Les atteintes à la propriété intellectuelle des logiciels
Avant de voir par quels moyens vous pouvez protéger votre création logicielle contre le « piratage » voyons qui peut attenter à vos droits.
– Comme on vient de le voir, toute entreprise ou tout individu qui se procure une version « piratée » de votre solution est dans l’illégalité. Idem pour le fait d’installer plus de postes utilisateur que prévu dans le contrat de licence. Quant à prétendre vendre ou louer sa licence d’utilisation c’est tout aussi interdit.
– La situation est plus complexe pour un développeur qui intègrerait dans sa solution tout ou partie du code de votre logiciel. Il s’agit là de contrefaçon et il vous appartient de porter le litige devant les tribunaux puis d’apporter la preuve premièrement que vous êtes bien le titulaire des droits et deuxièmement qu’il y a bien contrefaçon. Le régime pour les logiciels est en cela strictement identique à toute autre création intellectuelle (livres, films, dessins, marques, inventions, musiques….)
Le monde du logiciel libre
Impossible de terminer ce paragraphe sans aborder la question des logiciels libres. La question est tellement vaste que je préfère vous envoyer vers le site du mouvement GNU
En pratique…
Voici pour finir quelques informations complémentaires :
-
Combien coute la protection de l’innovation ?
- Une enveloppe Soleau : 15 €
- Un nom de domaine internet : de 5 à 25 €
- Déposer une marque française : à partir de 200 € pour 3 classes
- Déposer un dessin ou un modèle : de 40 à plus de 1000 €
- Déposer un brevet Français : de l’ordre de 5 000 €
- Déposer un brevet Européen : de l’ordre de 50 000 €
- Déposer un brevet Mondial : de l’ordre de 150 000 €
-
Quelle est la durée de protection ?
- œuvres de l’esprit : illimitée pour les droits moraux et 70 ans après la mort de l’auteur pour les droits patrimoniaux
- Marque déposée : 10 ans renouvelable indéfiniment
- Dessins et modèles : 5 ans renouvelable (maximum 25 ans)
- Brevet d’invention : 20 ans non renouvelable
- Enveloppe Soleau : 5 ans renouvelable une fois
-
Qui peut m’aider dans ma démarche de protection ? (en France)
- Le contact BPI France (ex-Anvar et ex-OSEO) de votre région
- Le service ARIST de votre CCI
- Les conseils en propriété industrielle
- Jetez un coup d’œil sur le site 180-380. Vous y trouverez les règles de base de l’innovation, illustrées et très clairement présentées.
Liens vers l’analyse fonctionnelle et l’analyse de la valeur
- Le site officiel de l’AFAV (Association Française pour l’Analyse de la Valeur). Ce site semble avoir (momentanément ?) disparu du net. De toute façon l’AFAV est une structure un peu poussiéreuse.
- Knowllence, éditeur de toute une famille de logiciels pour l’innovation
Les PME et leur projet d’innovation
- Si vous êtes dans une PME, votre interlocuteur institutionnel incontournable pour le financement de votre projet d’innovation est BPI-France plus connu sous sa précédente identité « OSEO »
La propriété industrielle
- Pour tout savoir sur la propriété intellectuelle, le site de l’INPI (Institut National de la propriété industrielle)
- Le site de l’office européen des brevets
- Pour faire une recherche ou déposer une marque : la base marques de l’INPI
- PATENTSCOPE, le portail officiel de recherche en propriété industrielle (recherche mondiale parmi 76 millions de documents)
La veille et l’intelligence économique
- Le site de l’ADIT (Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique)
- Le site personnel de Erwan Neau très documenté et bourré de liens
Les démarches de projet d’innovation : Triz et Asit
Sur la méthode Triz, réputée complexe.
- Un site entièrement consacré au gourou, créateur de la méthode, Genrikh Altshuller
- La matrice de résolution des contradictions
La méthode Asit, présentée comme une variante simplifiée de Triz
- la méthode ASIT par solidcreativity
Les cartes heuristiques (ou mind-mapping)
Sans être un outil exclusif de la gestion de projets d’innovation, la carte heuristique est très pratique pour mettre en ordre des listes hiérarchisées (PBS et WBS), et surtout un très bon support pour les séances de recherche créative.
- Probablement le plus répandu : MindManager
- La version française de FreeMind, excellent logiciel en open source.
- XMind propose 12 modes de présentation, parmi lesquels le diagramme de Ishikawa, un simple tableau et des arbres dans tous les sens. XMind propose également une fonction de travail collaboratif en ligne.
- FreePlane est un équivalent de Freemind, avec quelques différentes de détail. Également gratuit. FreePlane a cependant le mauvais gout de cannibaliser les fichiers que vous avez créé avec FreeMind.
- Une solution de mind-mapping en ligne : mindmaps
Les sites dédiés au mind-mapping
- Pétillant, un site entièrement consacré aux cartes heuristiques
- heuristiquement également dédié au mind-mapping
Testez vos connaissances
En tant que visiteur, vous avez accès à une version limitée du QCM (10 questions). Pour accéder à la version intégrale (20 questions prises au hasard parmi plus de 110) vous devez souscrire un abonnement PREMIUM. Je souhaite voir les offres d'abonnement PREMIUMC’est parti pour 10 questions
Quelques précisions sur ce test sur le projet d'innovation
- La participation à ce test est totalement libre : pas besoin de laisser vos coordonnées, elles ne vous seront pas demandées. La bonne réponse à une question ainsi que des explications supplémentaires vous seront fournies avant que vous ne décidiez de passer à la question suivante.
- Vous devez répondre à 10 questions. Chaque bonne réponse vaut 1 point. A la fin du test, vous aurez votre note sur 10 ainsi que notre commentaire.
Voici quelques-uns des thèmes abordés dans les différentes questions :
Acceptabilité du produit * Analyse de la valeur * Analyse défectuologique * Analyse fonctionnelle externe * Analyse structurelle * Approche marketing * Arbre fonctionnel * Besoins objectifs * Besoins subjectifs * Brainstorming * Brainwrigting * Brevet d'invention * Cahier des charges fonctionnel * Canevas stratégique * Caractérisation des fonctions * Carte heuristique (Mind-mapping) * Carte mentale * Cas d'utilisation (Use case) CDCF * CDCM * Client-utilisateur * Concept de produit * Concepteur-réalisateur * Conception à cout désigné * Conception à coût objectif (CCO) * Conception à cout objectif global (CCOG) * Contrefaçon * Courant de valeur * Couts non récurrents * Couts récurrents * Cycle de vie commerciale du produit * Cycle de vie du produit *
Dépot de marque * Design * Désirabilité * Dessins et modèles * Diagramme d'interaction (Pieuvre) * Diagramme de Kano * Durabilité du produit * Enveloppe Soleau * Ergonomie * Financement de l'innovation * Fonctions du produit * Hype cycle de Gartner * Iceberg des coûts * Idéalité * Idéation * Innovation de rupture Innovation incrémentale * INPI * Installation-pilote * Invention * Maquette * Maquette fonctionnelle * Marché * Marchés BtoB et BtoC * Marketing * Marque déposée * Matrice d'attractivité * Matrice OSEO * Méthode Asit * Méthode TRIZ * Mind-mapping * Modèle d'affaire (Business model) * Mots inducteurs * Mur technologique *
Obsolescence organisée * œuvres de l’esprit * Processus créatif * Profils d'innovation * Profitabilité du produit * Projet d'innovation * Propriété industrielle * Propriété intellectuelle * Prototype * Purge * Pyramide de Maslow * Recherche d'antériorité * Remue-méninges (Brainstorming) * Rentabilité de l'investissement * Rosace d'interaction * Schéma heuristique * Sérendipité * Signes distinctifs * Stratégie de différentiation * Stratégie Océan Bleu * Théorie CK * Tueurs d'idées * Typologie des fonctions * Utilisabilité du produit * Utilité, satisfaction et performance * Veille stratégique * Veille technologique *
Cet article comporte 0 commentaires